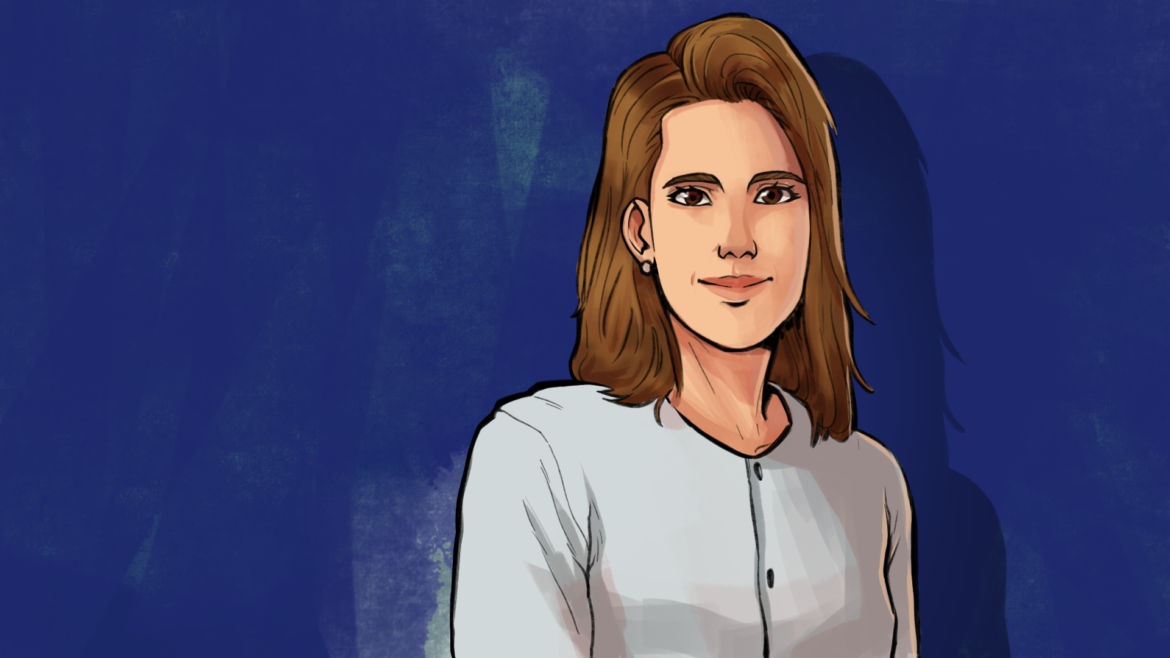La journaliste Marianne Grosjean adresse un message dans chacune de ses chroniques. Ce mois-ci, elle s’attaque à un paradoxe: celui d’un système qui rembourse les thérapeutes tout en les tenant à l’écart des médecins.
Alors, à combien reviennent vos primes? Et avec la complémentaire? J’ai toujours été fascinée par la particularité suisse de rembourser toute une série de thérapeutes grâce à l’assurance complémentaire – ce qui fait baver d’envie tous les naturopathes, acupuncteurs et autres kinésiologues établis en France – et d’un autre côté, de ne faire aucun lien entre ces métiers et la médecine classique dans la politique de la santé publique…
Me revient en tête la déception de ma réflexologue pendant la pandémie: «Nous autres thérapeutes jouons un grand rôle pour le maintien en bonne santé des patients. Or, un corps sain va pouvoir combattre un virus. Je croyais que cette pandémie allait forcément créer des ponts entre médecins et thérapeutes. Qu’en parallèle de la recherche d’un traitement, les médecins conseilleraient à tous de veiller à leur santé générale: de sortir s’aérer dans la forêt, de manger sainement, de contrôler leurs carences, de garder des contacts sociaux et de faire des check-up réguliers chez leur thérapeute. A l’inverse, nous aurions pu être un relais: inciter un patient dont on sent l’immunité baisser à être particulièrement vigilant et à se faire vacciner, par exemple.»
Et si on avait raté une occasion de mieux faire? J’ai tendance à imaginer les métiers de la santé comme un cerveau avec ses deux hémisphères. D’un côté, l’approche physiologique, qui consiste à maintenir le corps en bonne santé, pour qu’il puisse réagir au plus proche de la manière pour laquelle il a été conçu. De l’autre, l’approche pathologique, qui va détecter ce qui dysfonctionne, s’attaquer au problème et éradiquer la maladie. D’après ce que j’ai retenu de mes anciens cours de biologie, la bonne marche du cerveau consiste en un bon transfert des in- formations d’un hémisphère à l’autre, bref, en une excellente communication. Or, que se passe-t-il lorsqu’un hémisphère fonctionne tout seul? Il compense ce qu’il peut, mais ne peut pas être aussi performant que si les deux hémisphères travaillaient ensemble.
Reprenons nos métiers de la santé: lorsque ceux axés sur la pathologie fonctionnent en vase clos, c’est l’emballement dicté par la peur de la maladie. Pendant la crise du Covid, la peur nous a fait commander 61 millions de doses de vaccin, soit six piqûres pour chaque habitant, du nourrisson au vieillard! Résultat? Nous n’en avons utilisé qu’un quart et jeté près de 1,5 milliards de francs à la poubelle.
De l’autre côté, si les métiers axés sur la physiologie fonctionnent eux aussi en vase clos, ils refusent de voir les dangers. Cela nous a donné des antivax qui niaient l’existence de complications graves ou des guérisseurs qui prétendent nous délivrer de cancers avec des décoctions de plantes. Et parallèlement, un dialogue presque impossible entre les deux camps.
Pour éviter une situation aussi regrettable à l’avenir, pourquoi n’investirions-nous pas un peu d’argent et de volonté politique dans la bonne communication entre ces deux mondes? Que les divers corps de métiers de la santé échangent sur leurs savoirs, leurs expériences, leurs résultats? Qu’ils écoutent et comparent l’expérience de leurs patients respectifs et les mettent en commun? Y aurait-il vraiment un problème à ce qu’un gastroentérologue envoie son patient faire des irrigations du côlon régulières chez un professionnel? Ou à ce qu’une psychiatre recommande sa patiente en burn-out à une coach de vie?
L’enjeu est le même pour tous: améliorer la santé générale, et accessoirement faire baisser les primes.
La journaliste Marianne Grosjean adresse un message à nos lecteurs dans sa chronique.