L’être humain est son propre maître

Le bénévole Thu Saw Oo conduit l'ambulance de la Marga Society au Myanmar, photographié par Eva Hirschi.
Dans les pays où l’Etat est peu développé, l’engagement citoyen bénévole est florissant, comme le montre ce reportage réalisé en 2019 dans un service d’urgence birman, chez les chefs de section en Sierra Leone et à la recherche de personnes disparues en Biélorussie.
Nous sommes assis sur des chaises dans une sorte de salle de classe dans la ville de Hpa-An, au Myanmar, lorsque le téléphone de Thu Saw Oo sonne de manière inattendue. Une urgence ! Le jeune birman de 22 ans se lève d’un bond, se précipite vers l’ambulance et se jette sur le siège du conducteur. Trois autres jeunes hommes en uniforme bleu montent à l’arrière de la voiture. Cʼest parti : avec le gyrophare et lʼexpression faciale sérieuse, les quatre membres de lʼorganisation bénévole Marga Society se rendent au domicile dʼun patient souffrant de troubles cardiaques. Un transfert d’urgence vers l’hôpital est nécessaire.
Thu Saw Oo n’est pas médecin, ni même étudiant en médecine ou infirmier. Il étudie la chimie en troisième année et s’engage dans cette organisation bénévole pendant son temps libre, gratuitement. Marga Society est active dans différents domaines: dons de sang, cours de soutien scolaire, funérailles et, justement, services de secours. Certes, il y a un hôpital à Hpa-An qui possède aussi des véhicules de secours, «mais en général, les gens nous appellent directement. Ils savent que nous sommes plus rapides», explique Thu Saw Oo en dépassant une voiture de manière routinière. L’hôpital n’a pas la capacité de répondre rapidement et de manière adéquate à tous les appels d’urgence.
Les Birmans font davantage confiance aux bénévoles
Arrivé chez le patient, Thu Saw Oo prépare la civière pliable pendant que les autres volontaires se précipitent vers le patient dans la maison. Quelques minutes plus tard, tout le monde est de nouveau dans la voiture, l’homme est emmené à l’hôpital et confié aux soins des médecins. «Nous avons suivi un cours de sauvetage organisé par l’Etat et de temps en temps, une ou deux personnes parmi nous peuvent suivre une formation de deux semaines en Thaïlande», explique Thu Saw Oo. La formation en Thaïlande est offerte gratuitement par un hôpital local, les frais de voyage sont pris en charge par la Marga Society. «L’idée est que les participants transmettent ensuite leurs connaissances aux autres bénévoles».
Le président bénévole, Aung Than Lwin, considère que la mission de l’association Marga Society est complémentaire: «Nous soutenons le gouvernement. Il ne peut pas s’occuper de tout.» Cela sonne comme une évidence, aucune critique ne transparaît dans sa voix. Pourquoi accepter une telle tâche volontairement et sans compensation? «Parce que nous sommes un pays sous-développé», dit le quinquagénaire qui travaille comme gérant d’hôtel. Il considère cela comme un service à l’Etat, mais encore plus comme un service à la société. Alors que la Suisse, même en tant que pays hautement développé, mise sur un système de milice dans le but d’intégrer les expériences du monde du travail dans la politique (lire les articles p. 22-24, p. 28-31 et p. 32-35), l’activité des volontaires est tout simplement une nécessité pour les pays en développement.

Au Myanmar, un tel engagement de la société civile est une tradition. Depuis trois décennies déjà, les organisations à but non lucratif complètent ou remplacent les services qui devraient être pris en charge par l’Etat. Après l’effondrement de la «voie birmane vers le socialisme» sous le général Ne Win en 1988, de petites organisations ont vu le jour, souvent à partir de groupes religieux, dans lesquelles les citoyens ayant des intérêts similaires se rencontraient et organisaient des activités sociales ou religieuses avec un financement privé. Sous le régime militaire qui a suivi, encore plus de fonds publics ont été détournés vers l’armée, laissant la population plus ou moins à son propre sort. Les organisations de la société civile ont pris le relais pour combler le manque de prestations de l’Etat.
Les catastrophes naturelles ont également entraîné une augmentation du nombre de ces organisations. La réponse spontanée de la population aux ravages du cyclone Nargis, qui a fait plus de 130’000 morts en 2008, a notamment renforcé les organisations bénévoles. Au lieu d’attendre l’intervention de l’Etat, la population s’est organisée elle-même et a commencé à distribuer de l’aide et à nettoyer, notamment parce que le gouvernement a refusé l’accès à la zone sinistrée à plusieurs organisations internationales et n’a pas laissé entrer les aides étrangères, même de l’ONU, dans le pays. Mais les organisations locales ainsi que l’engagement des individus ont favorisé la cohésion de la société.
Une autre raison de la tradition de l’engagement gratuit est que la religion a une grande importance au Myanmar: «J’aide les autres parce que je veux faire de bonnes actions en tant que bouddhiste», dit Min Thein Htoo. Le jeune homme de 23 ans est membre de la Marga Society depuis six ans déjà. La grande générosité des Birmans est étroitement liée au bouddhisme. La Marga Society à Hpa-An compte environ 170 donateurs et donatrices qui donnent une contribution chaque mois. «Le nombre de dons, mais aussi de bénévoles, a augmenté ces dernières années», explique Aung Than Lwin. Cela montre que les gens savent apprécier les services de l’organisation.
Des chefs au lieu de présidents de communes en Sierra Leone
Du siège passager de l’ambulance au Myanmar, mon voyage m’emmène sur une moto en Sierra Leone – mais qui rend l’âme prématurément. En fait, nous voulons aller jusqu’à Sinekoro, mais une panne nous empêche de continuer. Je me retrouve donc, avec un chauffeur et un guide, dans un petit village appelé Bandakarifaya dans le nord du pays. Avant de pouvoir nous occuper de la moto, nous devons, selon la tradition, saluer le chef du village. Le chef de section Moses Karifa Marah, un homme âgé en jogging et bonnet de laine sur la tête, nous serre la main. Il me regarde avec suspicion et demande à mon guide si je travaille pour une organisation non gouvernementale (ONG). Très peu de personnes viennent en Sierra Leone uniquement pour le tourisme, la plupart sont des travailleurs humanitaires, des missionnaires ou des diplomates.
En fait, c’est la curiosité pure qui m’a amenée dans ce petit pays d’Afrique de l’Ouest, surtout connu chez nous pour les diamants du sang et Ebola, la grande pauvreté et la faible espérance de vie. Plus tard, alors que j’attends à l’ombre d’une maison que la voiture soit réparée, Balla Koroma me rejoint, vice-ministre de la jeunesse du village et l’un des rares habitants du village à parler anglais – et ce, même si l’anglais est obligatoire à l’école. Il m’explique aussi le rôle de Moses Karifa Marah qui, en tant que chef de section, équivaut à peu près à un président de commune. En effet, la Sierra Leone possède elle aussi un système fédéral: les différents niveaux administratifs s’appellent provinces, districts et chefferies.Avant la colonisation britannique, la Sierra Leone possédait déjà un système de chefferie, où différentes régions étaient dirigées par des chefs locaux. Les Britanniques ont utilisé cette base pour mettre en œuvre leur politique de contrôle indirect en 1896, c’est-à-dire exercer leur pouvoir par le biais de dirigeants locaux. Cela s’est produit aussi bien dans la colonie de la couronne de la péninsule de Freetown que dans le protectorat à l’intérieur du pays. Les grands districts ont été divisés en petites chefferies et les chefs traditionnels des districts ont été rebaptisés chefs Paramount, ce qui signifiait pour eux une perte de pouvoir et de territoire. Après plusieurs coups d’Etat militaires, la Sierra Leone a finalement proclamé une république présidentielle en 1971. La structure administrative a été en grande partie conservée.
Un système de milice comme en Suisse peut être trouvé ici à un niveau inférieur : les chefs Paramount sont certes payés par l’Etat pour leur fonction, mais chaque chef Paramount peut nommer des chefs de section locaux pour ses régions, qui – notons-le – ne sont pas rétribués pour diriger ce qu’on appelle une section. Ils sont responsables de la collecte des impôts, du maintien de l’ordre et de la résolution des conflits. «Le chef de section assume aussi les tâches de la police», m’explique le vice-ministre de la jeunesse. «Finalement, notre police ne peut pas être partout. Si un délit se produit dans le village, c’est d’abord le chef de section qui est la personne à contacter. Il décide si le cas doit être transmis à la police ou si une autre solution peut être trouvée. Nous n’avons pas assez de policiers.»

Il est difficile pour un chef de section d’exercer un travail à temps plein en plus de son activité de milice qui prend beaucoup de temps, dit Koroma. Mais il arrive que des chefs de section comme Moses Karifa Marah travaillent aussi comme agriculteurs dans les champs pour gagner de l’argent avec la récolte vendue. Ou ils participent à des affaires et gagnent ainsi de l’argent. Souvent, les chefs de section recevraient aussi des dons volontaires de la population, comme le riz et l’huile de palme, ou retiendraient une partie des fonds des ONG, avec l’argument (pas toujours valable) comme salaire justifié pour la mise en œuvre d’un nouveau projet.
Au manque de ressources humaines s’ajoute la difficulté d’accès à certains villages. En Sierra Leone, les routes goudronnées n’existent presque qu’entre les grandes villes. Les villages sont reliés entre eux par des pistes de bosses poussiéreuses, ce qui rend encore plus difficile la présence permanente d’une structure policière supérieure. En comparaison d’autres institutions de résolution des conflits, les chefs traditionnels jouissent de toute façon d’un plus grand respect et d’une plus grande confiance que la police. Dans une étude menée par la Banque mondiale, environ 80% de la population a déclaré que les chefs de section et les chefs de village résolvaient bien les conflits et favorisaient la cohabitation pacifique. La population de la Sierra Leone aurait également une opinion relativement mauvaise de la capacité de résolution des conflits dans les tribunaux de district. Ils ont indiqué qu’il y avait souvent des retards et que l’obtention de la justice dépendait souvent de la richesse d’une personne.
La méfiance règne aussi souvent vis-à-vis des parlementaires de la capitale Freetown. «Les politiciens ne viennent nous voir qu’avant les élections», dit Koroma. «La dernière fois, ils nous ont par exemple promis de construire un pont sur la grande rivière pour que nous puissions enfin atteindre le village avec des véhicules normaux et ne pas devoir toujours pousser la moto à travers la rivière», raconte-t-il. On peut effectivement voir les prémices de la construction d’un pont sur la rive. «Depuis les élections, personne n’a levé le petit doigt, ils nous ont à nouveau oubliés.» Le changement de régime de l’an dernier a mis en veilleuse de nombreux projets lancés par le gouvernement précédent dans tout le pays. Cela contribue également à ce que la communauté au niveau micro-local soit considérée comme beaucoup plus importante que le gouvernement dans la capitale lointaine.
Le bénévolat forcé en Biélorussie
La situation est inversée dans un Etat autoritaire, où l’appareil d’Etat est considéré comme le seul maître. En Biélorussie, pays du socialisme réel qui a obtenu son indépendance avec la chute de l’Union soviétique en 1991, le président Alexandre Loukachenko dirige le pays en autocrate depuis 1994 – certains le qualifient même de dictateur. En Biélorussie, le peuple a peu de choses à dire et certaines initiatives sont étouffées dans l’œuf si elles ne conviennent pas au gouvernement, par exemple les actions des groupes LGBT. Pourtant, il existe une sorte de bénévolat forcé, que l’Etat biélorusse vend sous le nom de «volontariat». Pour le soi-disant subbotnik (qui vient du mot russe pour samedi, subbota), les employés de l’Etat sont régulièrement invités à faire du «travail volontaire» un samedi spécifique. Il peut s’agir d’une journée nationale de nettoyage des rues, du dépouillement des votes, du ramassage de bois dans la forêt ou de la réparation des routes. La subbotnik nationale a lieu une fois par an, généralement en avril. De tels travaux peuventégalement être organisés au niveau régional ou local, à n’importe quel moment de l’année, et pas seulement par les autorités, même par des entreprises individuelles. Alors que l’Etat se vante que chaque année plus de trois millions de citoyens participent volontairement à des projets publics sans être payés, les experts juridiques et les organisations de défense des droits de l’homme considèrent cela comme de la pure propagande: «La subbotnik est déclaré comme travail volontaire, mais en réalité, c’est du travail forcé», déclare Valiantsin Stefanovic, vice-président de l’organisation biélorusse de défense des droits de l’homme Viasna.
Ces journées de travail non rémunérées remontent à 1919, lorsque les bolcheviks russes ont dû mobiliser les travailleurs pour reconstruire l’Etat après la fin de la guerre civile – sans pouvoir les payer pour cela. Dans la tradition socialiste soviétique, le travail est considéré comme un devoir et non comme un droit. «Les subbotniks sont cependant contraires à la loi nationale, le contrat de travail ne stipule pas ces tâches supplémentaires», explique Stefanovic. Bien sûr, les enseignants ou les fonctionnaires ont mieux à faire le samedi que de nettoyer les rues pour l’Etat. La participation aux subbotniks est volontaire, mais comme les employés de l’Etat en Biélorussie n’ont souvent qu’un contrat de travail d’un an, les employeurs ont ainsi un moyen de pression : Viasna connaît des cas où des personnes qui n’ont pas participé à un subbotnik n’ont pas vu leur contrat de travail prolongé ou n’ont pas reçu certaines primes.

Le rapport des Nations-Unies sur la situation des droits de l’homme critique également chaque année la Biélorussie pour cela ; en 2018, le rapporteur spécial de l’ONU alors responsable des droits de l’homme en Biélorussie, Miklós Haraszti, a écrit que «l’obligation» de participer aux subbotniks était déguisée par le gouvernement en «encouragement appuyé», mais qu’il s’agissait en fait de «travail forcé». Dans une situation économique où de nombreuses personnes sont déjà sous-employées et ne veulent perdre leur travail à aucun prix, ce moyen de pression pèse lourd: «Il n’y a pas de compensation ou quelque chose de similaire lorsque le contrat de travail arrive à échéance», dit Stefanovic. Alors qu’en Suisse, selon les données de l’Office fédéral de la statistique, environ 15% des employés travaillent pour l’Etat ou des entreprises proches de l’Etat, en Biélorussie, ils sont environ 40%.
La recherche privée de personnes disparues
Il existe toutefois aussi en Biélorussie de véritables projets bénévoles rendant des services à la communauté que l’Etat ne rend pas. C’est le cas de l’organisation de bénévoles Angel, qui coordonne les recherches de personnes disparues. En Biélorussie aussi, c’est la police qui s’en charge, mais il semble qu’il y ait un besoin d’aide supplémentaire. Sergey Kouhan ne veut pas le dire exactement, mais déclare: «La police est au courant de notre organisation – elle ne nous soutient pas, mais elle ne nous met pas non plus de bâtons dans les roues.» Dans un pays autoritaire, c’est déjà un signe de reconnaissance.
L’idée de fonder Angel est venue à Sergey Kouhan par hasard. En 2012, le comptable érudit a vu à la télévision l’appel d’une femme qui avait perdu son père âgé. Il serait parti dans la forêt et ne serait pas revenu. «S’il te plaît, aide-moi à le chercher», implorait-elle en pleurant face à la caméra. Sergey Kouhan a voulu l’aider. Et il a été le seul à venir. Il a demandé de l’aide à des amis et finalement, ils ont trouvé le père. Par la suite, le bruit s’est répandu que quelqu’un prenait en main la recherche des personnes disparues. «J’ai reçu des demandes pour chercher d’autres personnes», dit-il. Il a alors créé une page Facebook, puis des comptes sur d’autres réseaux sociaux ont été ajoutés, ainsi qu’un site Internet. Aujourd’hui, l’organisation est l’une des plus grandes et des plus connues du secteur en Biélorussie. Et il semble que la population ait attendu une telle organisation. Aujourd’hui, les personnes concernées appellent d’abord Angel et ensuite seulement la police pour signaler une personne disparue, car elles savent qu’Angel agit plus rapidement. Récemment, raconte Kouhan, une fillette a été portée disparue dans un grand parc. Avec des volontaires, ils ont fouillé le parc. Quand ils ont retrouvé la fille, la police venait d’arriver. Souvent, les forces de l’ordre ne peuvent pas être très réactives, car elles doivent attendre la permission écrite de leurs supérieurs.
De même, les mesures de recherche de la police semblent souvent ne pas suffire, car Angel mise surtout sur la recherche publique. «Parfois, nous imprimons des affiches et les affichons dans la ville, parfois nous contactons les médias locaux, mais la plupart du temps, nous publions un message sur les réseaux sociaux», explique Kouhan. «Parfois, nous retrouvons une personne en trente minutes parce que quelqu’un voit le post Facebook et se trouve par hasard à proximité de la personne disparue et la reconnaît grâce au post», poursuit Kouhan. En Suisse, en revanche, seule une fraction des disparitions est rendue publique par la police; comme argument pour l’utilisation restrictive des recherches publiques, la police invoque la protection de la personnalité des individus concernés.
Rendre service à la communauté
Angel, en revanche, organise même dans certains cas des recherches publiques où la population est invitée à apporter son aide, par exemple pour passer systématiquement une forêt au peigne fin. Cela fonctionne bien: «Souvent, plusieurs centaines de personnes participent à une opération. L’année dernière, plus de 2000 volontaires ont participé à une opération de recherche, c’était incroyable», partage Julia Kouhan, l’épouse d’Angel, responsable de la communication. Rien que l’année dernière, Angel a mené 97 opérations de recherche. 52 personnes ont été retrouvées vivantes, et 26 mortes.
Aujourd’hui, même la police fait appel à Angel. L’organisation s’est en effet professionnalisée au cours de ses six années d’existence. Sergey Kouhan a suivi une formation pour les services de recherche et de sauvetage en Russie et a collecté des fonds pour acheter un équipement de recherche professionnel. Angel ne dispose pas seulement de matériel de plongée, mais aussi d’un réseau de plongeurs amateurs engagés auxquels il est possible de faire appel en cas d’urgence, par exemple lorsqu’un enfant est porté disparu près d’une étendue d’eau. «Parfois, les autorités empruntent même notre matériel», dit Kouhan avec fierté. La police manque de ressources – pas seulement de personnes, mais aussi de moyens financiers – pour se procurer le matériel adéquat. «Toutefois, nous ne soutenons pas l’Etat, mais les gens», souligne Kouhan.
Manque de confiance dans les autorités, plus de capacités et d’expertise ainsi que le désir de faire quelque chose pour le bien commun: l’engagement de milice et l’engagement volontaire reposent sur des motivations différentes. Même si, à première vue, il m’a souvent semblé bizarre que des services tels que le sauvetage ou la recherche de personnes soient assurés par des bénévoles plutôt que par les hôpitaux publics ou la police nationale, il s’est avéré, lors des entretiens, qu’il n’y avait derrière cette réalité ni lassitude ni mécontentement envers l’Etat. Les volontaires voulaient plutôt rendre service à la communauté – c’est ce que les gens ont souligné au Myanmar, en Sierra Leone et en Biélorussie.
Et c’est exactement ce qui existe finalement en Suisse, même au niveau politique, précisément grâce au système de milice. Dans d’autres pays, en revanche, cela peut paraître incompréhensible – pourquoi un paysan, une femme au foyer, un artiste ou une physicienne devraient-ils assumer des tâches politiques alors qu’ils ne sont ni formés ni payés pour cela? On ne peut donc pas dire de manière générale ce qui relève de l’Etat et ce qui relève du bénévolat. Comme chez nous, les gens dans d’autres pays ressentent de la fierté et la satisfaction à faire quelque chose de bien en assumant des tâches aussi importantes pour l’Etat. Au lieu de critiquer et de nous plaindre (et cela vaut pour tous les pays), nous, les citoyens, devrions simplement prendre certaines choses en main. Car, d’une certaine façon, une communauté ne fonctionne que lorsque ses membres créent quelque chose ensemble.
Au gré des numéros, Le Regard Libre traduit des articles du magazine alémanique Schweizer Monat. Eva Hirschi est journaliste indépendante et dirige investigativ.ch, le Réseau suisse des journalistes d’investigation.







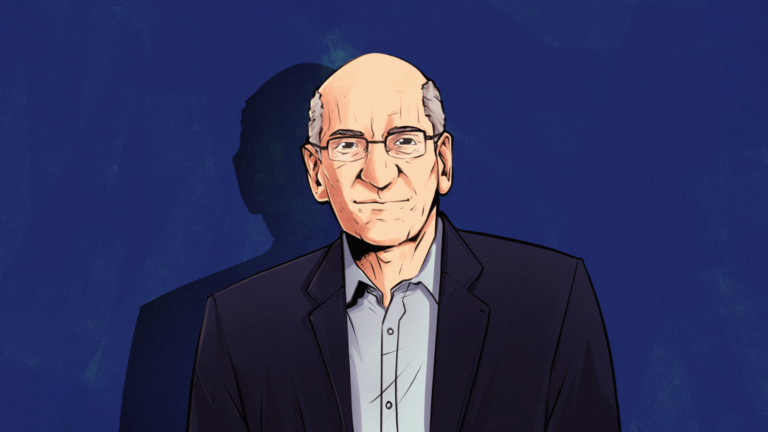

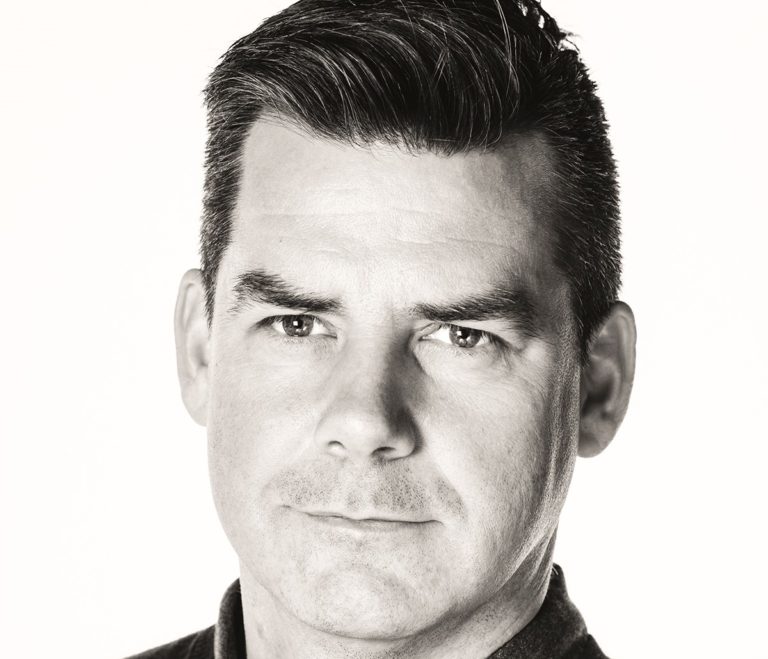
Laisser un commentaire