Le théâtre du grincheux

Le Regard Libre N° 51 – Ivan Garcia
Dans un petit village autrichien, Bruscon, comédien d’Etat, emménage avec sa famille dans une auberge pour préparer la représentation d’une pièce qui l’a rendu fameux. Entre répétitions théâtrales et longs monologues cyniques et désabusés, Bruscon parle au grincheux en chacun de nous.
Avant le début de la représentation, sur le plateau, un aubergiste, vêtu avec une petite toque de chef et un gilet de peau, légèrement enrobé, dort sur un tabouret. Comme promis par l’annonceur, un lever de rideau, inspiré de Jacques le fataliste et son maître, laisse entrer deux clowns, au look de punks avec des tee-shirts «Sex Pistols». Après quelques galipettes, nos deux clowns-punks, en bons philosophes, se lancent avec l’aubergiste, dans une longue dissertation sur le destin: «tout ce qui arrive de bien ou de mal est écrit là-haut.»
Alors, le spectateur s’interroge: si tout est déjà écrit, à quoi cela sert-il de lutter contre l’inévitable? Au lieu de cela, faisons les pitres! Et voilà donc asséné, le fil conducteur de la fable qui se dévoilera, bientôt, à nos yeux. En attendant, l’aubergiste, en tant que force tranquille, se dresse droit et ferme face au chaos hurlant incarné par les bouffons. Suite à une légère lutte, les trois personnages sortent, le lever de rideau prend fin et s’ouvre sur Le faiseur de théâtre.
Un protagoniste qui «a la haine»
La fable représentée se résume – assez – simplement: Bruscon et sa famille s’installent dans le petit village d’Utzbach, contrée rurale de l’Autriche. Au sein de l’auberge, le comédien d’Etat ne cesse de répéter au tenancier que, pour que sa fameuse pièce «La roue de l’histoire» soit un succès, il faut absolument éteindre la lumière de la sortie de secours et qu’il vaudrait mieux que le chef des pompiers ne s’oppose pas à cela. Avec cette condition sine qua non en tête, les spectateurs suivent Bruscon dans ses longs soliloques sur l’art, le théâtre, la misère intellectuelle et ses relations familiales.
Le père Bruscon a tout de l’image du vieil artiste décrépi et déchu; cheveux gris et barbe non-taillée, long manteau noir, haut et sec, de faible santé, il rend la vie intenable à ses proches. Nul ne devine réellement le motif qui l’a conduit à venir s’installer à Utzbach. Or, au vu de son caractère peu enviable, nous pouvons supposer que la «grande ville» ne supporte plus ce comédien un tantinet trop psychorigide. Bruscon, comme diraient certains jeunes, «a la haine»: il digresse, seul, en vociférant, en donnant des ordres, soit à ses enfants, Sarah et Ferruccio, soit à l’aubergiste qui, bon gré mal gré mais toujours stoïque, supporte son hôte. Et ce, même lorsqu’à plusieurs reprises, Bruscon, scandalisé par ce qu’il considère comme des atteintes à «son Art», éclate en disant: «Tous des nazis!», «Cette Autriche, tous des nationaux-socialistes!» et autres joyeusetés historiques.
Sur le plateau, comme pour souligner son autorité, Bruscon commande les déplacements des autres personnages. Tout d’abord, l’aubergiste qui doit déplacer quatre fois la table du comédien à des angles différents de la scène. Ensuite, son fils, Benjamin, un «comédien raté», selon son géniteur, et qui, le bras cassé, doit s’entraîner à «bien tirer le rideau» – on soulignera, notamment, le comique de situation très réussi. En effet, Ferruccio, avec son bras plâtré, s’efforce, parfois sans succès, à tirer ce rideau de droite à gauche et vice-versa, sur ordre de son père qui, bien content de l’humilier, se fait un plaisir de faire durer le supplice pour le garçon manchot.
Quelques attitudes et gestuelles de Bruscon – regards langoureux, caresses inappropriées, prise sur les genoux,… – envers sa fille, Sarah, tendent à nous dévoiler une relation particulière avec des sous-entendus incestueux entre ces deux personnages. En effet, et ce exclusivement à l’égard de sa fille, il se montre souvent soucieux et veille «à ne pas gâter son talent» et «qu’elle ne se fasse pas contaminer par les autres ratés», notamment sa mère qui – la pauvre – ne fait pas de grands traits de l’esprit.
«Utzbach comme Butzsbach»
D’ailleurs, de Madame Bruscon, parlons-en! Il s’agit (presque) du personnage le plus effacé de la pièce; absente jusqu’environ aux deux tiers de la représentation, à l’heure du «bouillon à l’omelette». Dès son arrivée, elle semble malade et tousse souvent, ce qui l’empêche de répondre aux invectives de son mari. Or, chose intrigante, Madame Bruscon possède le privilège d’avoir le «mot de la fin», puisqu’elle clôt la représentation en enjambant le corps de Bruscon, frappé d’une sorte de crise cardiaque. Nous pourrions considérer cela comme une sorte de vengeance de la part de ce personnage ou, comme nous l’allons montrer tout à l’heure, le rappel d’une sorte de fatalité mise en avant par la représentation, à travers la figure de la roue.
Le personnage le plus effacé de toute la pièce n’est pas Madame Bruscon, mais bel et bien le chef des sapeurs-pompiers du village d’Utzbach. En effet, souvent mentionné, ce dernier n’apparaît jamais physiquement sur scène mais se voit relayé par l’aubergiste qui assure la liaison entre lui et Bruscon. Aussi, alors que son rôle de décisionnaire – accordera-t-il l’autorisation à Bruscon d’éteindre la lumière de la sortie de secours pour sa représentation ou non? – lui octroie un rôle prédominant dans l’intrigue de la pièce, les attentes du spectateur finissent par être quelque peu déçues par l’auteur, Thomas Bernhard. Alors que le public se prépare à quelques embûches dressées par le chef des pompiers à l’encontre de ce vieux Bruscon, rien n’y fait… L’autorisation d’extinction parvient, par la bouche de l’aubergiste, sans aucune difficulté; la lumière de la sortie de secours ne relève pas vraiment d’un réel problème; il ne s’agit, en fait, que d’un simple signe contingent qui, de toute manière, n’empêchera pas la fatalité de se produire: la roue de la fortune tourne.
D’ailleurs, comble du malheur, ce cher protagoniste atterrit dans ce village d’Utzbach qu’il déteste par-dessus tout. A plusieurs reprises, celui-ci soulignera cette dichotomie entre la campagne Utzbach et Butzbach, la ville, en employant la formule «Utzbach comme Butzbach». Plus qu’une simple expression, celle-ci recouvre tout un réseau de dualités venant opposer – du point de vue de Bruscon – Utzbach à Butzbach. Premièrement sur la question du succès et de l’anonymat, alors qu’à Utzbach Bruscon et sa famille sont d’illustres inconnus, en ville, à Butzbach, ils jouissaient de leur statut de «comédiens d’Etat». Deuxièmement, la gastronomie s’invite à la tablée critique: alors qu’à la campagne, on élève des porcs pour fabriquer des saucisses et que l’on mange du «bouillon à l’omelette», Bruscon soliloque sur sa nostalgie des mets raffinés de la ville et son dégoût du «bouillon à l’omelette».
La «roue de l’histoire»
Rien ne laisse le spectateur plus curieux que cette fameuse pièce qui, dans l’univers de la fable, devrait être représentée, sur la scène du village, par la famille de Bruscon. Intitulée «La roue de l’histoire», nous pourrions y voir un simple deux ex machina ou un motif narratif permettant à l’intrigue de se tisser. Or, à bien y réfléchir, dans ce détail réside probablement une clef de lecture de la représentation. Essayons donc de savoir de quel sujet traite «la roue de l’histoire». Bruscon en souffle quelques mots à l’aubergiste en mentionnant les personnages de Staline, d’Hitler, de Churchill et même de Napoléon. A vrai dire, nous n’en savons pas grand chose, si ce n’est peut-être que Ferruccio incarne mieux ses personnages lorsqu’il a le bras cassé, et que celle-ci prend la forme d’une gigantesque fresque polyphonique où la plupart des grands personnages historiques se rencontrent. Sous couvert d’invisibilité, cette «roue de l’histoire» symboliserait alors cette main invisible qui guide les hommes vers la tragédie.
Paradoxalement, à la fin de la représentation, «La roue de l’histoire» envahit la salle à la manière d’un symbole. Rappelons-le: alors que Bruscon et sa famille entrent en scène, un incendie se déclare au presbytère, laissant alors la salle se vider de son public. Le théâtre, déserté, dévasté tel un champ de ruines après la fuite des spectateurs, fend le cœur du pauvre Bruscon qui, de désespoir, de chagrin et de dépit, s’effondre et – probablement – meurt. Victime de son destin, le protagoniste finit broyer par cette roue qu’il avait lui-même mise en branle, évoquant ainsi le fait que les tragédies se répètent systématiquement.
Avec Le faiseur de théâtre, Thomas Bernhard, à travers une tirade de Bruscon, ce vieux grincheux, exprime son profond scepticisme – ou sa profonde lucidité, à vous d’en juger – sur l’art théâtral en s’exclamant que: «L’écrivain est mensonge, les interprètes sont mensonges et les spectateurs aussi sont mensonges et le tout rassemblé est une absurdité unique sans même parler du fait qu’il s’agit d’une perversité qui a déjà des milliers d’années. Le théâtre est une perversité plusieurs fois millénaire dont l’humanité raffole et elle en raffole si fort parce qu’elle raffole si fort de son mensonge et nulle part ailleurs dans cette humanité le mensonge n’est plus grand et plus fascinant qu’au théâtre.» Alors, chers lecteurs, peut-être touchons-nous-là au cœur d’une énigme fascinante: pourquoi nous autres, humains, prenons-nous plaisir à aller voir du mensonge au théâtre et, qui plus est, à faire partie de ce grand mensonge?
Ecrire à l’auteur: ivan.garcia@leregardlibre.com
Crédit photo: © Philippe Pache
-
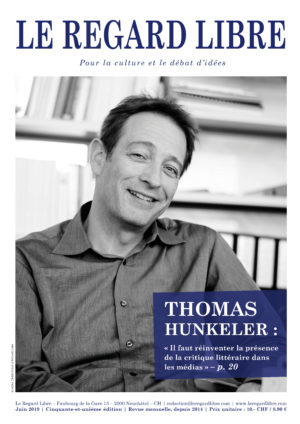 Le Regard Libre – N° 51CHF10.00
Le Regard Libre – N° 51CHF10.00 -
 Abonnement standard (Suisse)CHF100.00 / année
Abonnement standard (Suisse)CHF100.00 / année -
 Abonnement de soutienCHF200.00 / année
Abonnement de soutienCHF200.00 / année
Le faiseur de théâtre / D’après le texte de Thomas Bernhard / Mise en scène de Jean-Luc Borgeat / Compagnie du Milan Noir / Pulloff Théâtres (Lausanne) / du 30 avril au 19 mai 2019










Laisser un commentaire