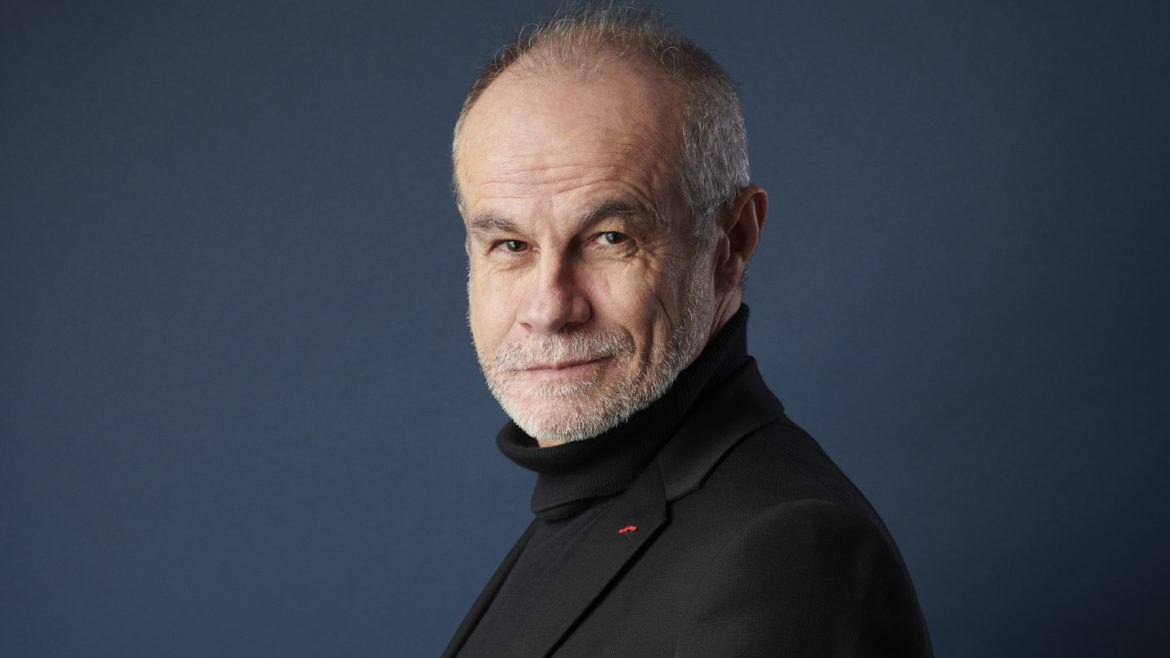La place de l’automobile suscite un débat majeur dans de nombreuses villes. Entre défis de mobilité, environnement et qualité de vie, des pistes de transformation émergent pour repenser les espaces urbains. Entretien avec l’urbaniste Carlos Moreno.
La voiture a longtemps été perçue comme le symbole de la liberté individuelle. Aujourd’hui, sa place est remise en question dans de multiples agglomérations qui repensent leurs modes de mobilité et leurs espaces publics. L’urbaniste franco-colombien Carlos Moreno est l’une des figures phares de ce mouvement. Professeur à l’Institut d’administration des entreprises (IAE) Paris-Sorbonne, son concept de la «ville du quart d’heure» a inspiré des politiques publiques aux quatre coins du monde.
Le Regard Libre: Vous affirmez régulièrement que la voiture n’a plus sa place dans la ville du XXIe siècle. Pourquoi?
Carlos Moreno: Je suis convaincu que la voiture individuelle, et plus encore la voiture thermique, n’a plus sa place dans les zones urbaines denses, là où vivent aujourd’hui de nombreuses personnes. Ces espaces exigent avant tout un usage réfléchi de l’espace public afin de garantir une bonne qualité de vie. Or, dans ces zones, les voitures monopolisent une part démesurée des voies de circulation, souvent pour un usage inefficace. Elles sont fréquemment utilisées par un seul conducteur et ne font que transiter. Dans certaines villes, si l’on inclut la voirie et les parkings en surface, jusqu’à 60 à 70% de l’espace public est consacré à l’automobile. Ce modèle d’occupation n’est tout simplement pas compatible avec une vie urbaine de qualité. Concrètement, quels sont les impacts négatifs de la voiture dans les zones denses? Avant tout la dégradation de la santé des habitants qui vivent dans ces zones denses, au contact permanent des voitures thermiques. Ce ne sont pas seulement les émissions de CO2 – un des principaux gaz responsables du réchauffement climatique – qui sont en cause mais aussi des particules fines, notamment les PM2,5, qui représentent une menace grave et silencieuse pour la santé publique. Ce sont des polluants invisibles, mais redoutables, comparables à un poison lent comme le sucre. Le débat ne se résume pas à être pour ou contre la voiture. Il s’agit avant tout de justice spatiale. Dans les zones denses, d’autres modes de déplacement sont possibles: à pied, à vélo, en transports en commun. Une ville devrait être un lieu de lien social, pas un espace où l’on se donne le droit de polluer au détriment des autres. D’autant plus que l’espace public, financé collectivement, représente un coût élevé. Lorsqu’il est accaparé par une minorité de personnes à bord de véhicules d’une tonne générant des nuisances, cela interroge profondément notre modèle de société.
Vous parliez des voitures thermiques. Leur interdiction de vente en 2035 dans l’Union européenne soulève de nombreux enjeux. Mais sur le plan urbanistique, la voiture électrique change-t-elle vraiment la donne?
Si j’ai surtout évoqué la voiture individuelle thermique, c’est parce qu’elle reste largement utilisée dans les métropoles, souvent pour de très courtes distances. Selon les données issues de l’enquête annuelle sur les transports en France, plus de 50% des déplacements en voiture concernent des trajets de moins de 6 km (ndlr : en Suisse, la distance moyenne pour les trajets domicile‑travail est de 14 km et 50% des pendulaires utilisent la voiture comme mode de transport principal, selon des données de l’Office fédéral de la statistique datant de 2023). C’est un non-sens en milieu urbain dense. Quant à la voiture électrique, elle ne règle pas le problème de fond. Un embouteillage reste un embouteillage, qu’il soit composé de véhicules thermiques ou électriques. La congestion reste l’une des principales nuisances urbaines. Il faut aussi tordre le cou à certaines idées reçues: la voiture électrique, elle aussi, émet des particules fines. Celles-ci proviennent notamment de l’usure des freins, des pneus en polymère et du contact avec la chaussée. Ces poussières restent en suspension dans l’air, et leur impact sur la santé est bien réel. La voiture électrique peut avoir sa place dans des zones de faible ou moyenne densité, à condition qu’elle soit utilisée de manière partagée, avec plusieurs personnes à bord. Mais en zone dense, la seule voie d’avenir, ce sont les mobilités alternatives: la marche, le vélo, les transports en commun. Il faut tourner la page de la voiture en ville au XXIe siècle.
Vous soulignez souvent l’occupation de l’espace par les voitures. Pourquoi est-ce un enjeu urbanistique?
C’est un héritage du XXe siècle. Pendant des décennies, notamment dans les pays occidentaux, on a considéré comme normal qu’une voiture puisse stationner librement dans l’espace public, souvent à l’extérieur. En Europe, cette pratique est largement répandue, contrairement à certaines régions d’Amérique latine, où des questions de sécurité limitent ce phénomène. Prenez l’exemple de Rome: la ville compte quasiment autant de voitures que d’habitants, et une majorité de ces véhicules «dorment» dehors. Cela représente une appropriation injustifiée de l’espace public. On parle alors de «voitures ventouses». Il faut rappeler qu’une voiture est utilisée en moyenne moins de 3% de sa durée de vie. Le reste du temps, elle est à l’arrêt. Lorsqu’elle est stationnée en surface, cela se fait au détriment d’un espace qui pourrait être utilisé autrement, pour de la végétalisation, des places de jeux pour les enfants ou des espaces de rencontre. C’est cette logique qui pousse de plus en plus de métropoles à supprimer les parkings en surface, à introduire des parcomètres ou à réaménager ces zones pour d’autres usages. Cette contrainte nouvelle amène les conducteurs à se questionner sur la nécessité réelle de posséder une voiture. D’autant plus qu’on estime qu’en ville, environ 25% des voitures en circulation le sont uniquement pour chercher une place où se garer.
Vous êtes à l’origine du concept de la «ville du quart d’heure». Pouvez-vous nous en résumer l’essentiel?
La «ville du quart d’heure», qu’on appelle aussi «ville de la proximité», repose sur une idée simple: réorganiser la ville de manière à rapprocher les services essentiels des habitants. Il s’agit de créer une ville polycentrique, où chaque quartier offre un accès facile, idéalement en courtes distances à pied ou à vélo, aux principaux besoins du quotidien: commerces, soins, écoles, culture, espaces verts ou encore lieux de sociabilité. L’objectif est d’éviter que le lieu de résidence ne soit réduit à un simple «toit pour dormir», obligeant les gens à parcourir de longues distances pour travailler, se soigner ou faire leurs courses. Il s’agit au contraire de favoriser une vie de quartier riche, active et connectée, où le lien social peut se renforcer. C’est une façon de redonner à la ville son rôle fondamental: offrir de la qualité de vie sans dépendre systématiquement de la voiture ou de déplacements contraints.
Certaines villes ont commencé à mettre en œuvre vos recommandations. Quel premier bilan peut-on en tirer?
Le bilan est très positif, et ce, sur tous les continents. Prenons l’exemple du Mexique: qui aurait imaginé que Mexico, une des plus grandes métropoles du monde, allait développer les «Utopías», ces unités territoriales de proximité? Ce sont des espaces où l’on trouve une combinaison de services culturels, éducatifs et commerciaux accessibles à 15 ou 20 minutes à pied ou à vélo. Autre exemple: la ville de Busan, en Corée du Sud, fortement connectée. Lors des dernières élections municipales, le projet de ville du quart d’heure était au cœur du débat. Le maire élu a transformé la ville en y développant des lieux multiusages, y compris dans l’Hôtel de ville lui-même, qui abrite désormais un espace de rencontre multimédia pour les enfants. Dans la ville, un système incitatif a aussi été mis en place: avec un code QR, les habitants qui fréquentent des lieux de commerce ou activités en proximité cumulent des points sur une carte, qui deviennent des bons d’achat. S’ils se déplacent à pied, ils peuvent cumuler des extra-points, quand ils atteignent les 10 000 pas enregistrés. Cela crée une dynamique économique circulaire et locale. Ce qui est intéressant, c’est que ces réussites ne concernent pas uniquement les grandes métropoles. Le concept fonctionne aussi parfaitement bien dans les villes moyennes ou petites, car il n’est pas lié à la densité ou à la taille.
Dans la ville du quart d’heure, la voiture est reléguée au second plan. Mais dans certains cas, les aménagements nécessaires ne représentent-ils pas un coût très important?
Très important, c’est relatif… Il faut distinguer deux types d’investissements. D’un côté, il y a des aménagements à faible coût. Il s’agit de transformer des infrastructures existantes en infrastructures sociales, un terme utilisé dans le monde anglo-saxon. Concrètement, cela signifie qu’un lieu physique peut accueillir plusieurs usages: une mairie qui héberge aussi des activités culturelles ou associatives, un commerce qui devient un lieu de vie, de formation ou de rencontres. Il s’agit surtout de repenser les usages, plus que de reconstruire. De l’autre côté, il y a des investissements dans les infrastructures de mobilité. Cela implique par exemple d’élargir les trottoirs, de réduire le nombre de voies dédiées aux voitures, ou encore de créer des pistes cyclables sécurisées. J’insiste sur le mot «sécurisées»: une simple ligne au sol ne suffit pas. Il faut une séparation physique entre les cyclistes et les voitures avec des barrières. Ces investissements peuvent sembler conséquents, mais ils sont largement rentabilisés. Comme le disait Fred Kent, fondateur du mouvement Placemaking: «Si vous planifiez des villes pour les voitures, vous obtiendrez des voitures. Si vous planifiez des villes pour des personnes et des lieux, vous obtiendrez des personnes.» C’est exactement ce qu’on observe à Paris, où l’on a désormais plus de 1 200 kilomètres de pistes cyclables, qui rendent la capitale comparable à Amsterdam en termes d’usage des vélos.
Le modèle de la ville du quart d’heure est-il réellement transposable à toutes les villes?
Chaque ville ayant un contexte propre, il ne s’agit pas de faire un copier-coller du concept de la ville du quart d’heure, mais bien de l’adapter à chaque territoire. Ce n’est pas non plus une baguette magique qui transforme une ville du jour au lendemain. Nous parlons ici de déconstruire près de 70 ans d’un urbanisme fondé sur les longues distances, la voiture individuelle et la séparation stricte des fonctions urbaines avec des zones monofonctionnelles: quartiers résidentiels, zones commerciales, zones d’affaires, etc. C’est une logique héritée de l’après-guerre, mais qui trouve ses racines dès les années 1930, lorsque Henry Ford commence à produire des voitures à grande échelle. Depuis, les villes ont évolué en donnant toujours plus de place à l’automobile. Aujourd’hui, il s’agit de renouer avec une autre histoire de la ville. Dès la fin du XIXe siècle, certains urbanistes avaient déjà compris que faire de la voiture le centre de la ville nous ferait perdre une part de notre humanité. Cela avait notamment conduit aux projets des villes-jardins. Tout au long du XXe siècle, d’autres urbanistes proposeront des villes plus humaines. Changer cette logique demande des plans stratégiques de long terme. Si Paris est devenue une référence en matière de transformation urbaine, c’est parce que le travail a commencé il y a plus de 25 ans. On ne redessine pas une ville en quatre ou cinq ans.
Qu’en est-il des villes américaines, où la voiture occupe une place prédominante dans l’organisation urbaine?
Le cas des villes américaines est un débat passionnant. En juin, lors de la célébration du 10e anniversaire des Accords de Paris, était présente la maire de Phoenix, dans l’Etat du Texas, l’un des plus dépendants du pétrole, puisque son économie repose en grande partie sur cette ressource. Phoenix est aujourd’hui pleinement engagée dans une démarche de ville de proximité. A Cleveland, dans l’Ohio, une ancienne capitale de l’industrie automobile, le maire Justin Bibb est lui aussi totalement impliqué dans ce processus. A Portland, dans l’Oregon, la proximité est au cœur de la stratégie urbaine depuis des années. Donc ce n’est pas une fatalité. Ce n’est pas parce qu’une ville a été construite autour de la voiture qu’elle est condamnée à le rester. Concernant Los Angeles par exemple, c’est effectivement une ville éclatée géographiquement, conçue pour la voiture, mais cela signifie justement qu’il faut inverser notre manière de penser. On me dit souvent: «Les villes américaines sont comme ça.» Je réponds qu’elles n’ont pas à le rester éternellement. Il faut bien commencer un jour.
Derrière l’idée de proximité, ne se cache-t-il pas une vision normative de l’urbanisme et de la mobilité, qui dicte à chacun comment vivre, se déplacer, consommer?
J’entends cela avec un sourire, parce que personne ne dicte rien. Nous vivons heureusement dans des démocraties, même si certaines sont aujourd’hui fragilisées. Le concept de ville de proximité n’impose rien. Au contraire: il propose et offre des alternatives. Si j’ai une boulangerie à deux pas de chez moi, mais que je préfère faire une heure de voiture pour aller acheter mon pain ailleurs, libre à moi de le faire. Personne ne l’interdit. En revanche, traverser tout un centre-ville en voiture pour cela, en polluant l’espace public, n’est plus acceptable. Ce qu’on met en place, ce sont des règles collectives, fondées sur des enjeux de santé publique, de justice urbaine et d’environnement. Darwin disait que l’intelligence humaine est avant tout notre capacité à nous adapter. Ce qu’on observe, c’est que lorsque des services de proximité sont créés dans un quartier, les comportements changent naturellement. Les individus préfèrent aller près de chez eux que de traverser toute la ville.
Vous avez notamment collaboré avec Anne Hidalgo, maire socialiste de Paris, mais également avec Valérie Pécresse, présidente républicaine de la région Ile-de-France. Le modèle de la ville de proximité transcende-t-il les clivages politiques?
C’est un modèle qui cherche à privilégier la qualité de vie des habitants. En 2023, Valérie Pécresse m’a fait part qu’elle souhaitait lancer un plan stratégique en Ile-de-France, le SDRIF-E. Une grande partie des habitants de la région font chaque jour de longs trajets vers Paris pour accéder aux services. Elle veut donc développer de nouvelles centralités. Elle m’a aussi raconté que certains de ses conseillers étaient réticents, car ils estimaient qu’un tel programme reviendrait à «copier» la ville du quart d’heure portée par Anne Hidalgo, sa rivale politique. Elle leur a répondu: «Je ne copie pas Anne Hidalgo, je m’inspire des travaux du professeur Moreno.» Elle m’a demandé de venir à une réunion de travail pour l’expliquer. Je l’ai appuyée publiquement. Cela montre bien que c’est avant tout une question d’urbanisme du XXIe siècle.
La voiture a longtemps symbolisé la liberté: celle des grands départs, des récits de voyage, l’idée d’une autonomie individuelle. Aujourd’hui, certains en font même un symbole de résistance aux politiques écologistes. Votre vision de la transformation urbaine passe-t-elle également par une bataille culturelle?
Absolument. Le penseur italien Antonio Gramsci parlait déjà de cela: celui qui remporte la bataille culturelle trace la voie que suivra la société. Dans ses Cahiers de prison, il écrivait: «Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres.» Nous en sommes là: un monde façonné par la voiture refuse de disparaître. Pourtant, ce monde est très récent à l’échelle de l’histoire humaine. La voiture n’est omniprésente que depuis 90 ans environ, alors que les villes existent depuis 5000 ans si l’on remonte à la plus vieille en Mésopotamie. Sa place est donc marginale dans l’histoire, mais sa diffusion a été globale et rapide. En quelques décennies, la voiture est devenue un objet central dans nos vies. Elle a aussi symbolisé un statut social, dans un monde très masculin. On se souvient des images utilisées durant longtemps: une belle voiture, avec une femme séduisante à son bord pour déifier cet objet. Ce monde-là résiste. Il s’appuie sur une idée de liberté qui n’en est pas une: une liberté dans le sens libertarien, c’est-à-dire «Moi, moi, moi», sans aucun lien social ni vue collective. La bataille à laquelle je participe se dirige donc contre le «Je veux passer partout avec ma voiture parce que c’est moi et mon désir». Nous portons une autre vision de la ville, humaniste, avec un urbanisme de proximité où écologie, économie et interactions sociales vont de pair, un urbanisme de services pour la qualité de vie.
Journaliste et consultant, Pablo Sánchez est rédacteur au Regard Libre. Ecrire à l’auteur: pablo.sánchez@leregardlibre.com
Vous venez de lire une interview tirée de notre dossier «La bagnole sous la loupe» publié dans notre édition papier (Le Regard Libre N°119).
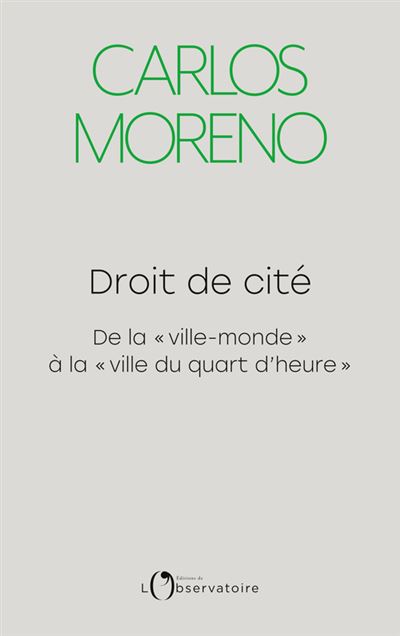
Carlos Moreno
Droit de cité. De la «ville-monde» à la «ville du quart d’heure»
Editions de L’Observatoire
Novembre 2020
192 pages