Selon David Betz, professeur au King’s College, l’Occident a franchi un seuil critique: l’affaiblissement de la légitimité politique, la fragmentation identitaire et la perte de cohésion sociale sont autant de facteurs d’insurrections violentes à venir.
David Betz est professeur d’études sur la guerre dans le monde contemporain au King’s College de Londres. Ses principaux domaines de recherche incluent l’insurrection et la contre-insurrection, la guerre de l’information, ainsi que les relations civilo-militaires et la stratégie. Sa thèse, annonçant l’émergence de violences de grande ampleur, a récemment gagné en notoriété au Royaume-Uni, un pays que le chercheur estime engagé sur la voie d’une guerre civile. Il est notamment l’auteur d’un article intitulé «The Future of War Is Civil War», publié dans Social Science (vol. 12, 2023), autour duquel cet entretien exclusif s’articule.
Le Regard Libre: Votre thèse centrale est que, dans un avenir plus ou moins proche, des conflits civils de grande ampleur sont inévitables dans un certain nombre de pays occidentaux. Avez-vous été marqué par un événement déclencheur ou s’agit-il d’une prise de conscience progressive qui vous a mené à développer ce scénario?
David Betz: Ma carrière universitaire a coïncidé avec les attentats du 11 septembre. Je me suis spécialisé dans l’étude de l’insurrection et de la contre-insurrection, en me concentrant notamment sur les aspects de psychologie de masse et communicationnels de ces phénomènes. Du fait de la manière dont ces conflits répercutent désormais leurs effets jusque dans les pays d’origine des puissances intervenantes via les réseaux de la mondialisation et les diasporas, j’ai été contraint de prendre en compte les dimensions domestiques de ces conflits: les réalités nationales et les interactions entre ces «théâtres» de guerre sont désormais interconnectées. Une caractéristique des guerres du XXIe siècle est justement qu’elles échappent à tout confinement géographique.
Le tournant décisif dans ma réflexion, cependant, a été le référendum de 2016 sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne (Brexit). Plus précisément, c’est la manière dont l’élite politique britannique a tenté de saboter l’exécution du mandat démocratique en utilisant tous les moyens à sa disposition qui m’a profondément choqué. Ce processus est aujourd’hui quasiment achevé: le gouvernement britannique actuel s’est, en substance, rendu à l’Union européenne (UE).
A lire aussi | Immigration: le Labour à l’épreuve de la réalité
Ce comportement m’est alors apparu particulièrement dangereux, car il compromet à la fois la stabilité sociale et la légitimité des institutions, deux piliers essentiels à la prévention des phénomènes insurrectionnels. La légitimité ne se réduit pas à la seule légalité, mais dépend plus largement du consentement à être gouverné. Ce consentement repose sur la perception nécessaire que le système politique répond aux préférences exprimées par les électeurs dans les urnes. Si une idée prévaut en matière de contre-insurrection, c’est bien celle selon laquelle la légitimité est le point névralgique du conflit.
Cet affaiblissement de la légitimité n’est pas un problème circonscrit à la Grande-Bretagne.
En effet. Aujourd’hui, une conviction devenue courante dans les pays occidentaux est que le vote ne sert à rien, que la politique n’est qu’un théâtre dénué de conséquences et dans lequel les décisions importantes sont prises en amont du processus démocratique. En d’autres termes, l’idée politique la plus fondamentale – la légitimité – s’est profondément étiolée. Celle-ci est, en somme, une forme de «magie» politique: si elle est présente, le coût de la gouvernance est faible; si elle fait défaut, ce coût peut devenir exorbitant. L’affaiblissement de la légitimité d’un système encourage les citoyens à s’y soustraire, voire à chercher à le renverser.
Il est par ailleurs assez révélateur que la peur d’une fragmentation violente de la société existe aujourd’hui jusqu’au sein des segments de la population britannique traditionnellement les plus attachés au statu quo.
Comment qualifieriez-vous les guerres civiles à venir?
J’emploie l’expression de «guerre civile» dans son sens le plus élémentaire, c’est-à-dire un conflit armé opposant des parties qui relevaient, au début des hostilités, d’une même autorité souveraine. C’est une définition minimale, mais suffisante. Ce terme fait toutefois l’objet de critiques en Occident: les futurs conflits internes ne mettront pas seulement aux prises des «compatriotes» au sens traditionnel du terme, mais plutôt une population autochtone et des communautés issues de l’immigration ne partageant pas nécessairement une allégeance envers la nation hôte, voire la rejetant. Cette expression permet d’englober tous les éléments sociaux, ethniques et politiques du conflit, tandis que des termes comme «révolte», «soulèvement» ou «révolution» capturent certes des aspects du phénomène, mais suggèrent plutôt un événement explosif et ponctuel.
Or, ce que je veux souligner, c’est bien le caractère progressif d’un processus qui s’inscrit sur le temps long et qui ne se terminera pas rapidement. Ce type de conflit sera le fait de groupes paramilitaires et de milices s’affrontant pour le contrôle de tel ou tel territoire, tandis que les forces conventionnelles restantes d’un Etat en déclin tenteront d’exercer une certaine influence sur les événements. Dans ce scénario, seuls quelques lieux fortement sécurisés pourront rester sous le contrôle total de l’Etat.
«Guerre civile» pourrait dont être traduit par processus insurrectionnels violents.
«Insurrection» est en effet un autre terme qui me paraît pertinent sur le plan analytique. Il désigne un mouvement social opposé au statu quo, qui transgresse les règles légales et institutionnelles afin d’obtenir des changements jugés inaccessibles par les voies politiques ordinaires. On peut la comparer à un iceberg: la partie immergée concentre les dynamiques profondes qui confèrent son énergie au phénomène, tandis que les violences représentent la pointe à la surface. Nous tendons à nous concentrer sur cette partie visible de l’insurrection, alors que ce qui devrait nous inquiéter, c’est la masse qui la propulse depuis les profondeurs. Une fois que celle-ci perce la surface, comme c’est le cas aujourd’hui, il est probablement trop tard pour l’arrêter. Ironiquement, les mêmes gouvernements qui, depuis vingt ans, étudient les manières de vaincre des insurrections à l’étranger semblent avoir appliqué à la lettre le manuel pour en provoquer dans leur propre pays.
Quels sont les facteurs clefs causant ce scénario?
J’observe la confluence de deux principaux vecteurs. Le premier est la révolte contre les élites, c’est-à-dire l’opposition entre ce que David Goodhart a appelé les Somewheres, les individus enracinés localement, et les Anywheres, les élites cosmopolites embrassant une idéologie postnationale et contrôlant très largement les institutions[1]. Cette dynamique n’est pas sans rappeler les révoltes paysannes en Europe entre le XIVe et le XVIIe siècle, causées par un mélange de facteurs économiques, sociaux, politiques et culturels, souvent amplifiées par des crises ponctuelles. Ce vecteur se manifeste de nos jours par l’émergence de mouvements sociaux mobilisés autour de l’idée que les Anywheres modifient les règles du jeu au détriment des intérêts et préférences de la majorité. En somme, la conviction que les élites ne respectent plus leur part du contrat social.
Le risque est que cette révolte évolue en «guerre sale», avec des caractéristiques que l’on observe, par exemple, dans certains pays sud-américains (attentats contre des juges, politiciens, journalistes), et, en retour, une répression sécuritaire qui ne fait qu’alimenter le phénomène. Si son capital de légitimité est épuisé, l’Etat sera réduit à réagir plus qu’à agir et ne pourra plus guère s’appuyer sur le sentiment patriotique ou le consentement des citoyens.
Quel est le second vecteur?
Celui de nature identitaire. Dans un contexte de violences croissantes, de désorganisation sociale et d’appauvrissement, les individus auront tendance à se replier sur leurs appartenances tribales latentes pour y rechercher sécurité et protection. Ce processus de ségrégation résidentielle par affinité videra progressivement les quartiers et les localités autrefois mixtes et consolidera des enclaves ethniques, un phénomène par ailleurs déjà observable dans certaines agglomérations européennes, à l’image de Bruxelles ou de Londres. Au Royaume-Uni, cette fracture est particulièrement prononcée entre les populations autochtones et musulmanes. En raison de leur importance numérique, de leur taux de croissance, de leur forte cohésion interne et de la solidité de leur identité religieuse, elles demeurent largement imperméables à l’assimilation. Les musulmans de deuxième ou troisième génération se révèlent même, dans bien des cas, plus éloignés de la société d’accueil que ceux de la première génération.
Au Royaume-Uni, vos travaux ont été favorablement accueillis par plusieurs podcasteurs et commentateurs politiquement modérés[2]. Comment votre thèse a-t-elle été reçue dans les cercles stratégiques et de défense?
Ma thèse a en effet rencontré un écho positif auprès d’une large frange du public, suggérant que de nombreuses personnes pressentent effectivement l’imminence du conflit. Beaucoup ont réagi en disant que ce que j’exprime correspond à des réflexions qu’ils nourrissaient en privé, mais qu’ils n’osaient pas formuler à voix haute.
A lire aussi | Notre dossier «Quand les élites sont irresponsables»
Sur le plan officiel, la réaction des cercles de défense et de stratégie a été prudente. J’ai eu néanmoins quelques contacts directs, ainsi que de nombreux indices suggérant que ces questions sont bel et bien débattues. Il est récemment apparu que le gouvernement britannique a évoqué la possibilité de conflits civils au niveau du Cabinet. Aucun gouvernement, toutefois, n’a à ce jour publiquement admis qu’il menait une planification de contingence pour une guerre civile. De manière non officielle, si j’en juge par les nombreux anciens hauts responsables de la police, figures politiques ou membres des services de sécurité qui m’ont contacté, il est évident que mes analyses sont largement partagées au sein de ces cercles.
Qu’en est-il du monde académique?
Il évolue lentement. Il faut souvent des mois, voire des années, pour qu’un débat y prenne forme et soit visible dans les bases de données de citations. Je suis néanmoins encouragé par le fait que des chercheurs issus de disciplines très variées m’ont contacté pour partager leurs travaux, souvent complémentaires aux miens. Mon propos n’a rien d’iconoclaste; nombre de chercheurs étaient parvenus à cette conclusion bien avant moi. L’idée que la confiance, élément essentiel du capital social[3], est en chute libre dans les sociétés occidentales est aujourd’hui un fait solidement documenté, et les théories sur les causes des guerres civiles sont claires: des sociétés polarisées, fracturées, avec des écarts d’attente[4] massifs et une perte de confiance dans les mécanismes politiques classiques, ont toutes les caractéristiques propices au déclenchement d’un conflit.
Comment interprétez-vous la fréquence des mouvements de protestation et des émeutes dans des pays comme le Royaume-Uni, la France ou les Etats-Unis? Est-ce l’ampleur, la nature ou le rythme de ces mobilisations qui révèle d’après vous une défaillance systémique?
Ces trois aspects me semblent importants et pointent tous dans la même direction. Les Etats sont généralement capables de gérer une ou deux protestations majeures, même lorsqu’elles dépassent les capacités locales, en mobilisant des forces depuis d’autres régions. Mais il y a des limites, et les Etats sont déjà sous tension.
A titre illustratif, il a fallu une semaine entière pour mettre fin aux émeutes et pillages à Londres en août 2011. Depuis, le nombre de policiers dans ce pays a diminué, en particulier ceux disposant de la formation et de l’équipement adéquats. Les protestations apparaissent souvent comme localisées, sporadiques et désorganisées. Aucune structure de coordination visible ne semble capable d’enchaîner les actions ou d’en moduler l’intensité de façon stratégique. A court terme, cela allège la tâche des services de sécurité, mais l’absence de direction identifiable prive le gouvernement de véritables leviers d’action. Il n’y a personne à coopter, à sanctionner ou avec qui négocier. Croire qu’un mouvement organique et sans leadership ne peut agir de manière stratégique est une erreur.
Comment des mouvements spontanés peuvent-ils faire des choix stratégiques?
Ces dernières décennies, l’évolution la plus marquante dans l’étude des réseaux terroristes et des phénomènes insurrectionnels a porté sur leur nature protéiforme et multicéphale. Les chercheurs s’accordent aujourd’hui à dire que ce qui les rend efficaces, c’est un récit stratégique cohérent et convaincant, un cadre interprétatif adressé à une «communauté de conscience», qui expose la gravité et l’urgence d’un ressentiment collectif, désigne un ennemi principal, propose une voie d’action claire (souvent violente, mais pas exclusivement), et invite à soutenir la cause d’une manière émotionnellement mobilisatrice.
L’objectif d’un tel récit n’est pas de prescrire aux individus une pensée ou une conduite précises. Il ne constitue pas un ordre opérationnel, mais un cadre interprétatif structurant la perception des événements. Une fois ce cadre établi, il tend à se renforcer de lui-même. Comme l’a formulé Victor Hugo[5], «rien n’est plus puissant qu’une idée dont l’heure est venue». Lorsque ce cadre est partagé par un nombre suffisant d’individus, l’orientation de leurs actions devient implicite: aucune instruction n’est nécessaire, chacun en déduit spontanément la conduite à tenir. Or, ce type de narratif stratégique a bel et bien pris racine dans l’imaginaire d’une partie des populations européennes, qui en viennent à croire qu’elles sont déplacées, rapidement et intentionnellement, dans leur propre pays. Elles ne l’ont jamais demandé; cela leur a été imposé, même lorsqu’elles l’ont explicitement refusé dans les urnes.
Vous identifiez le multiculturalisme comme une ligne de fracture majeure et le travail du politologue américain Robert Putnam sur le capital social semble être au cœur de votre réflexion. Comment la montée de la diversité ethnique en Europe s’articule-t-elle avec votre thèse?
Effectivement, les travaux de Robert Putnam sont fondamentaux. Bowling Alone[6] a démontré, de manière très convaincante, que le capital social joue dans une société le même rôle que le capital financier dans une économie. Putnam a proposé dans des études ultérieures – confirmées depuis par de nombreux chercheurs – que la diversité ethnique affaiblit le capital social. Cet affaiblissement se mesure notamment à la baisse de la confiance dans les rapports interpersonnels, à la diminution du bénévolat et de la charité, à la peur accrue de la criminalité, à un sentiment de solitude et d’aliénation généralisée. Face à ce constat, Putnam formulait l’espoir qu’avec le temps, les bénéfices du multiculturalisme se feraient davantage sentir, tandis que ses coûts s’amoindriraient. Malheureusement, cet espoir ne s’est pas réalisé et la cohésion sociale est aujourd’hui en rapide déclin. Or, l’absence de cohésion sociale est bien une des principales conditions favorisant le conflit civil.
Jusqu’il y a peu, l’idée que le multiculturalisme en Europe se révèle un échec patent était plutôt limitée aux marges du débats public.
Oui, et vous noterez qu’elle est à présent largement partagée. Cette réalité a d’ailleurs été explicitement reconnue par des figures que l’on ne peut guère accuser d’extrémisme. Il y a une dizaine d’années, le Premier ministre David Cameron (2010-2016) reprenait les propos tenus par la chancelière Angela Merkel (2005-2021) au sujet de l’Allemagne[7], avertissant que le multiculturalisme conduisait à la formation de communautés ghettoïsées et mutuellement étrangères[8]. Plus récemment, lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du Livre blanc sur la réforme de l’immigration, même le Premier ministre travailliste Keir Starmer évoquait le risque que l’immigration transforme la Grande-Bretagne en une «île d’étrangers», une déclaration qu’il a depuis désavouée[9].
A lire aussi | Le grand remplacement: retour au texte
D’ailleurs, si l’idée de «remplacement démographique» des Européens est aujourd’hui prise au sérieux jusque dans des segments modérés de la population, pourquoi les élites ne proposent-elles pas une interprétation alternative plus convaincante? Et pourquoi les autorités semblent-elles privilégier la censure, au nom de la lutte contre la «désinformation», allant jusqu’à emprisonner certaines figures d’opposition?
A vos yeux, quelles décisions ou quels événements ont accéléré ce phénomène démographique et social?
On pourrait en identifier en remontant parfois loin dans l’histoire, mais d’un point de vue plus pratique, je pense que c’est l’adoption d’une vision strictement économique par les gouvernements qui a causé le plus de dégâts. A partir du milieu du XXe siècle, les nations ont cessé d’être perçues comme des communautés humaines vivantes. Elles sont devenues, dans la perspective de ceux qui les dirigeaient, de gauche comme de droite, de simples bilans comptables, des tableaux de profits et pertes à l’échelle nationale. Et aujourd’hui que le navire commence à couler, les banquiers se saisissent du gouvernail. Cela explique, en partie, les trajectoires de figures comme Rishi Sunak au Royaume-Uni, Mark Carney au Canada, ou Mario Draghi en Italie.
Et si je devais désigner un moment de bascule au Royaume-Uni, je remonterais au gouvernement de Tony Blair (1997-2001), qui affirmait en 2000 avoir pour «but politique central» de transformer le pays par l’immigration, et de «frotter le nez de la droite dans la diversité»[10], selon ses propres termes.
Qu’est-ce qui vous fait penser que nous avons déjà franchi un seuil critique?
Pas un événement en particulier, mais plutôt la croissante réalisation dans les populations européennes que l’immigration de masse entraînera à terme des transformations démographiques qui altéreront profondément leur culture et leur société. Les projections pour le Royaume-Uni, par exemple, suggèrent que cette crainte n’a rien d’irrationnel[11]. Si cette idée a longtemps été associée à un conspirationnisme d’extrême droite, elle est à présent devenue presque banale. C’est cette prise de conscience, et le sentiment d’urgence qui l’accompagne, qui marquent le véritable basculement.
Existe-t-il un scénario dans lequel cette trajectoire pourrait être inversée?
Non. Je ne vois aucun scénario plausible permettant, dans le cadre des règles actuelles, de modifier significativement cette trajectoire. Il n’y a aucune véritable issue politique. Les partis antisystèmes, tels que Reform au Royaume-Uni, Alternative für Deutschland (AfD) en Allemagne ou le Rassemblement National en France, verront leurs perspectives électorales considérablement réduites par des procédés de «guerre juridique», c’est-à-dire de judiciarisation délibérée de l’adversaire politique, ainsi que par toute une panoplie de techniques éprouvées de défense du statu quo. Et même s’ils parvenaient à être élus et se révélaient réellement déterminés à changer les choses en profondeur, ces formations politiques se heurteraient à un mur d’obstruction administrative, à un sabotage bureaucratique constant.
Quels sont les pays européens qui présentent, selon vous, la plus forte probabilité d’un conflit civil violent?
Les travaux de la politologue américaine Barbara Walter[12] ont établi que, lorsqu’un ensemble de conditions propices à la guerre civile sont réunies, la probabilité annuelle d’un conflit est d’environ 4%. A partir de ce chiffre de base, chacun peut calculer la probabilité cumulative sur l’échelle temporelle qui l’intéresse.
Il faut ajouter à ces probabilités un élément important: l’un des facteurs prédictifs de guerre civile, c’est l’existence d’un conflit en cours dans un pays voisin. Autrement dit, si un seul pays sombre dans la guerre civile au sein d’un espace politique sans frontières réelles, comme l’UE, il faut s’attendre à ce que le phénomène se propage rapidement ailleurs.
Les pays les plus proches du point de rupture sont probablement la France et le Royaume-Uni. L’Irlande, cependant, présente à mon sens le risque le plus élevé d’explosion. Les mêmes tensions évoquées précédemment y sont présentes, peut-être même de manière plus intense, mais dans un contexte marqué par une histoire relativement récente de guerre civile et de résistance violente. Notons que tous les pays du continent ne présentent pas les mêmes risques. L’Europe de l’Est, par exemple, ayant été occupée par l’Union soviétique pendant des décennies, a été épargnée par les premières phases du processus occidental de déracinement et de déstructuration culturelle, dont les conséquences sont aujourd’hui si manifestes en Europe de l’Ouest.
Olivier Moos est docteur en Histoire contemporaine (Université de Fribourg et EHESS).
Vous venez de lire un article inédit en libre accès. Débats, analyses, actualités culturelles: abonnez-vous à notre média de réflexion pour nous soutenir et avoir accès à tous nos contenus.
[1] D. Goodhart, The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics, Hurst, 2017.
[2] Par exemple: «Is civil war coming to Britain? David Betz & Mary Harrington», UnHerd: https://www.youtube.com/watch?v=okLu7RgMoV4&ab_channel=UnHerd; «The Coming British Civil War – David Betz», Maiden Mother Matriarch, ép. 124: https://www.youtube.com/watch?v=Gid48FgiHho&ab_channel=MaidenMotherMatriarchwithLouisePerry
[3] Le capital social désigne l’ensemble des ressources matérielles, informationnelles et symboliques auxquelles les individus et les groupes peuvent accéder grâce à leurs réseaux de relations, aux normes partagées et à la confiance réciproque. Il favorise la solidarité et l’entraide, facilite l’action individuelle, et fonctionne comme un mécanisme qui réduit les coûts de coordination et de coopération. Facteur structurant de la vie sociale et politique, le capital social contribue à la qualité de la gouvernance et au développement économique.
[4] Le concept d’expectations gap désigne le décalage entre les attentes que les citoyens placent dans un système politique, et la capacité ou volonté réelle de celui-ci d’y répondre.
[5] Version apocryphe attribuée à Victor Hugo, développée à partir de son expression «On résiste à l’invasion des armées; on ne résiste pas à l’invasion des idées», qui apparaît dans son essai Histoire d’un crime, Calmann-Lévy, 1877. «Nothing is more powerful than an idea whose time has come» est la forme la plus courante en anglais.
[6] Robert D. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York: Simon & Schuster, 2000.
[7] «Selon Merkel, le modèle multiculturel en Allemagne a “totalement échoué”», Le Monde, 17 octobre 2010.
[8] «Multiculturalism has failed in Britain – Cameron», Reuters, 5 février 2011.
[9] «Starmer apologises for ‘island of strangers’ remark», Financial Times, 25 juin 2025.
[10] L’expression est attribuée à Andrew Neather, ancien conseiller de Tony Blair, Jack Straw and David Blunkett, dans un article intitulé «Don’t listen to the whingers—London needs immigrants», London Evening Standard, octobre 2009.
[11] Voir: Matt Goodwin, Demographic Change and the Future of the United Kingdom: 2022–2122, Centre for Heterodox Social Science Report No. 3, Université de Buckingham, 29 mai 2025.
[12] How Civil Wars Start: And How to Stop Them, Crown, 2022.



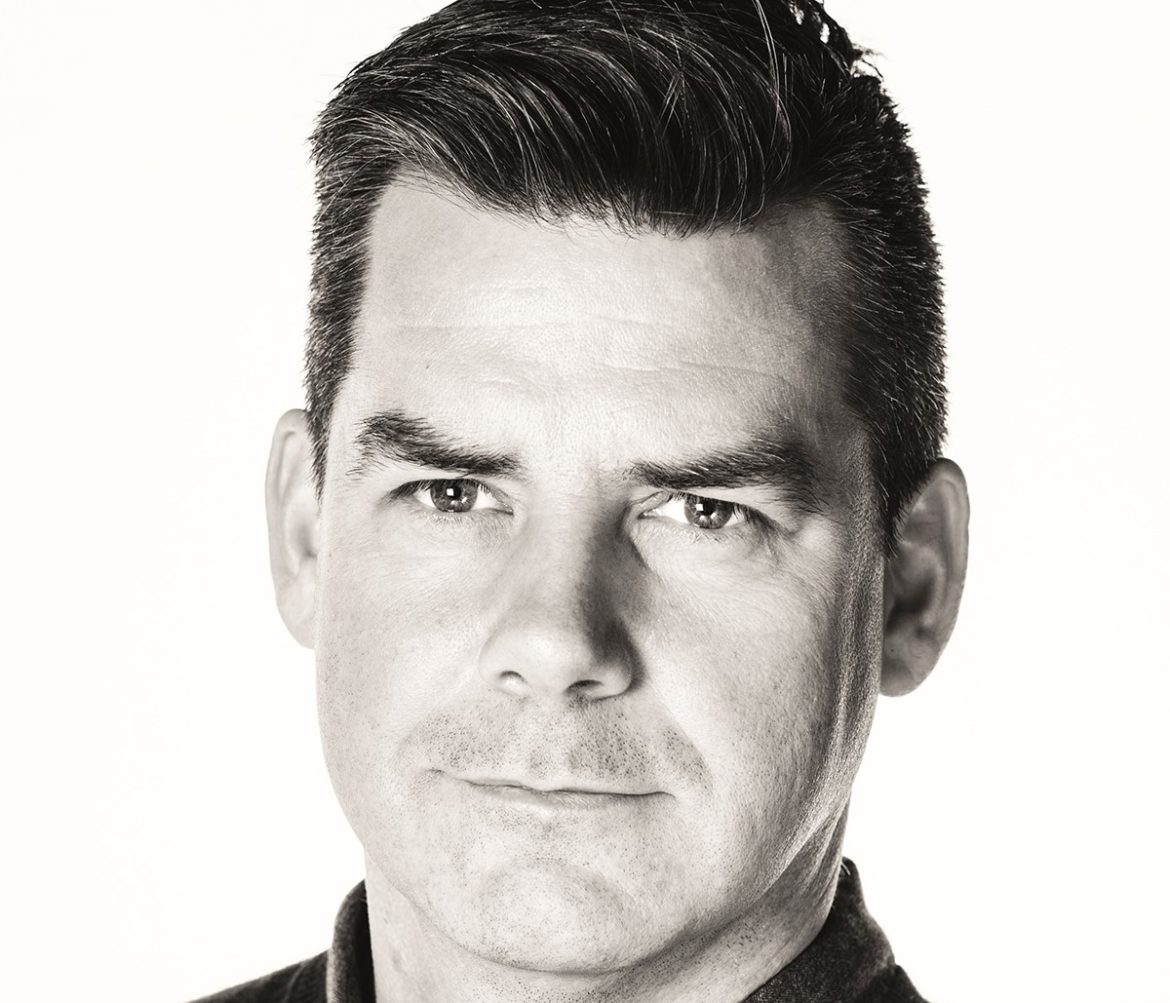
1 commentaire
Pour avoir vécu depuis 1980 dans la Seine Saint Denis….
C’est évident , que de futurs et graves mouvements populaires vont se former entre la France et “d’origine” et les deux fragments d’immigration et principalement les progénitures qui en sont issues principalement d’origine africaine, dont l’ensemble du Maghreb, et Afrique centrale.
Le système cache volontairement l’origine des habitants résidant dans divers régions de France.
Depuis 81, une politique de culpabilisation du incrémenté dans les esprits par le PS.
Dès lors le développements d’une haine anti-blanc “français ” c’est désormais installé , et face à 15/20 millions de français d’origine immigrée musulmans, peu de solutions existent pour rétablir un équilibre socio-culturel.