Le sociologue québécois Mathieu Bock-Côté fustige le «régime diversitaire» qui tend à remplacer la démocratie telle que nous la connaissons actuellement dans le monde occidental. Interview autour de son dernier livre La révolution racialiste.
Mathieu Bock-Côté a su s’imposer en quelques années comme un intellectuel de référence dans le monde francophone. Indépendantiste québécois, défenseur de l’héritage gaulliste, grand admirateur de Raymond Aron, il consacre son travail à l’analyse de l’évolution de notre société vers un nouveau régime qu’il appelle «diversitaire». Tout en critiquant les dérives de la gauche radicale – notamment dans ses ouvrages Le multiculturalisme comme religion politique et L’empire du politiquement correct –, il propose un modèle de société empreint du conservatisme dont il se fait le défenseur. En avril 2021, Mathieu Bock-Côté a publié son dernier livre La révolution racialiste, une critique acerbe de la mutation de la lutte antiraciste vers une nouvelle idéologie totalitaire. L’occasion de revenir avec lui sur quelques idées centrales de son œuvre et les actualités de la sphère intellectuelle.
Le Regard Libre: Le concept de «régime diversitaire» joue un rôle fondamental dans votre œuvre. Pouvez-vous le définir?
Mathieu Bock-Côté: Le «régime diversitaire», tel que je l’entends, est la transformation du régime démocratique par la réinterprétation de l’ensemble de ses principes, de ses institutions et de ses pratiques, à la lumière de la diversité. Il ne s’agit toutefois pas d’une diversité qui se présente comme la diversité des cultures, des peuples ou des idées, mais d’une diversité qui se pense à la manière d’un procès contre ce que l’on croit être la civilisation occidentale. Quelles qu’en soient ses manifestations (France, Québec, Canada, Etats-Unis), la civilisation occidentale se serait constituée autour d’une figure à mon avis phantasmée: l’homme blanc hétérosexuel dominant, qui se serait dissimulé derrière la nation, l’universalité, ou encore la culture commune, pour exercer son hégémonie. Le «régime diversitaire» est ce régime qui prétend déconstruire les institutions, la culture, la nation, en somme tous les référents partagés, pour qu’émerge cette «diversité» qui aurait été refoulée dans les marges de notre civilisation au fil du temps.
Quelle est la nature de cette diversité?
Il ne s’agit pas d’une diversité établie une fois pour toutes à partir de tel ou tel groupe. Il s’agit d’une diversité qui ne cesse de générer de nouvelles catégories à libérer, comme s’il y avait toujours de nouveaux groupes refoulés par l’histoire qui surgissent devant nous et exigent réparation. Le «régime diversitaire» prétend mettre en valeur une diversité «victimisée». En cela, c’est un régime à prétention révolutionnaire qui n’est jamais établi une fois pour toutes mais se déploie sans fin. Nous sommes témoins d’un éparpillement infini de la subjectivité qui conduit jusqu’à dire «je suis une victime donc je suis». C’est dans la mesure où un groupe se présente comme victime de la civilisation occidentale qu’il peut prétendre s’inscrire dans l’espace public avec une position privilégiée, et obtenir des avantages à la fois financiers, politiques et symboliques.
A lire aussi | Polémique à La Liberté: l’ère de la repentance
Dans vos différents ouvrages, on trouve une accusation grave contre ce «régime diversitaire», dont vous dites qu’il est potentiellement totalitaire. Comment justifiez-vous cette accusation?
Il y a au cœur de la modernité une tentation totalitaire insurmontable que l’on doit toujours combattre: 1793, 1917, la fin des années 60, le début des années 2020, en sont des exemples. Qu’est-ce que le totalitarisme? C’est la tentation de fusionner dans une même orthodoxie le Vrai, le Juste et le Bien, afin de recréer le monde et de le soumettre à l’obsession d’une idée à laquelle aucune pensée, aucune catégorie de la société ne doit se dérober. Un régime totalitaire exige une adhésion explicite et ritualisée à sa doctrine. Puisqu’on est très marqué par le XXe siècle, on se dit aujourd’hui que le totalitarisme est égal au goulag. Le goulag, certes, est une des modalités monstrueuses du totalitarisme, mais la logique totalitaire peut très bien s’en passer: il existe aujourd’hui de nombreux rituels d’adhésion au «régime diversitaire» qui sont assez fascinants – davantage de notre côté de l’Atlantique, mais ça viendra chez vous.
Pouvez-vous en donner quelques exemples?
On trouve dans les entreprises des ateliers de rééducation idéologique, où les gens de la catégorie sociale dominante – aujourd’hui les majorités occidentales – doivent s’accuser de leurs privilèges. Cette idée d’une rééducation nécessaire de la population est normalisée en Amérique du Nord. Autrement dit, les processus de socialisation, sinon naturels, du moins traditionnels, seraient fondamentalement corrompus par le racisme, le sexisme, la transphobie, etc. et il faudrait se rééduquer à la lumière de la «révélation diversitaire» pour être capable d’évoluer dans une société véritablement inclusive. La tentation totalitaire du «régime diversitaire» s’incarne aussi dans la persécution symbolique – mais de plus en plus juridique, voire politique – de la dissidence; l’assimilation du désaccord au discours haineux; la psychiatrisation du désaccord et de sa critique à travers la multiplication des «-phobies». On voit là la matrice du totalitarisme, qui, je crois, est le visage sombre de la modernité. La modernité n’est pas que cela, mais elle est aussi cela. Les sociétés occidentales doivent toujours combattre cette tentation qui réémerge à la manière d’une forme d’utopisme aux prétentions scientifiques, voulant accoucher de la société idéale en la délivrant du mal incarné dans une figure, autrefois l’aristocrate, ensuite le bourgeois, désormais l’homme blanc occidental.
A cette tentation totalitaire, vous opposez le régime de la démocratie libérale. En quoi le «régime diversitaire» et la démocratie libérale sont-ils si antagonistes?
Parce que la démocratie libérale est un cadre fondé par définition sur le pluralisme reconnu des options politiques légitimes. Elle prétend conjuguer dans un travail d’équilibrage qui n’est jamais définitif la souveraineté populaire et les libertés publiques. Elle n’institutionnalise pas une vérité censée déployer ses conséquences dans tout l’ordre social, mais intègre au contraire la possibilité d’un désaccord entre le conservatisme et le progressisme, le cosmopolitisme et l’enracinement, l’individu et l’autorité, et elle propose d’institutionnaliser la délibération pour que sans cesse le débat soit mené entre ces différentes options. Pour moi, les deux termes sont importants: «démocratie», parce que le pouvoir du peuple est important, et «libérale», parce que les libertés publiques sont absolument essentielles.
A lire aussi | L’édito de Jonas Follonier: Au-delà du clivage gauche-droite, la querelle de l’universel
En revanche, vous estimez que la démocratie libérale est insuffisante. Pourquoi?
La démocratie libérale est inimaginable si l’on ne pense pas la civilisation dont elle est la traduction politique. La démocratie libérale sans la nation, sans le patriotisme de civilisation, sans l’anthropologie fondatrice de nos sociétés, est un régime vide. C’est ce qui se passe aujourd’hui avec «le régime diversitaire». Celui-ci instrumentalise, dénature et falsifie les principes de la démocratie libérale en prétendant les accomplir. Même si j’aime Tocqueville passionnément comme observateur de nos sociétés et de la modernité – il définit la démocratie comme un processus appelé à toujours s’étendre sous la logique de l’égalité – ce n’est pas à sa manière que je lis la démocratie. La démocratie est pour moi, selon la conception aristotélicienne, un régime, et c’est en tant que régime qu’elle doit être pensée. Ensuite, comme opposition au «régime diversitaire», elle est insuffisante. Elle n’est que le cadre politique d’une civilisation qui dans son ensemble doit s’opposer à cette agression idéologique.
Tous ceux qui se réclament de la démocratie libérale seraient donc vos alliés objectifs face au régime diversitaire, porté par la gauche radicale?
Oui et non. Avec tous ceux qui acceptent de se situer dans l’univers mental de la démocratie libérale, nous ne serons pas ennemis, mais nous pouvons néanmoins être adversaires. Si j’accepte que vous gagniez des élections, et si vous acceptez ensuite que je les gagne, sans que nous ne cherchions à nous exclure mutuellement de la cité, nous avons des points communs devant le «régime diversitaire». Voilà pourquoi en France, la gauche républicaine et une bonne partie de la droite conservatrice ont de nombreux terrains d’entente, même si l’histoire de leur pays fait qu’ils n’arrivent pas à se reconnaître dans un projet politique partagé. Dans mon cas, par exemple, quand je suis en France (où j’arrive avec le privilège de l’étranger), ce que je dis est souvent entendu aussi bien à gauche qu’à droite. Pourquoi ? Parce que dans les faits, quand on accepte d’évoluer dans l’espace qu’est la nation et dans le régime qu’est la démocratie libérale, nous avons devant la gauche diversitaire beaucoup de points communs.
De ce point de vue, il est intéressant de constater qu’on en arrive à mettre sur le même plan, par exemple, Natacha Polony, Michel Onfray ou encore Alain Finkielkraut, en les accusant d’être réactionnaires, ou alors d’extrême-droite, alors qu’ils portent des projets politiques souvent radicalement différents.
Bien sûr! C’est le propre de l’union sacrée. Aujourd’hui, l’idéologie diversitaire n’est pas qu’une mode. Si on la prend au sérieux, ce qui est mon cas, il est nécessaire d’aller au-delà de nos préférences idéologiques particulières. Puis, il faut comprendre qu’il y a devant cette idéologie une psychologie «collabo» chez une partie des élites. On le constate notamment dans la bourgeoisie américaine. C’est assez fascinant. Elle est aujourd’hui la plus ardente promotrice du «régime diversitaire». C’est pourquoi je crois que les Etats-Unis sont perdus. Ce qui est dommage, car j’ai un côté un peu Michel Sardou sur le mode: «Si les Ricains n’étaient pas là, vous seriez tous en Germanie». Les Américains ont préservé la liberté à la première guerre, ils l’ont préservée à la deuxième sans le moindre doute, et contre les communistes de 45 à 89. Aujourd’hui, je pense que les Américains sont malheureusement entrés dans une logique de décomposition et nous devons tout faire pour ne pas nous laisser entraîner par elle. Les Etats-Unis menacent aujourd’hui la civilisation qu’ils ont hier sauvée.
Quels sont les dangers qui pèsent selon vous sur la démocratie libérale?
Il y a des gens qui cherchent à instrumentaliser la démocratie libérale pour l’abattre. Ce n’est pas nouveau. Il y a un détournement institutionnel, un transfert de souveraineté qui s’est opéré vers les tribunaux, vers la bureaucratie, vers les médias – c’est le propre du «régime diversitaire». Ce transfert de souveraineté fait qu’aujourd’hui, paradoxalement, le pouvoir politique est devenu un contre-pouvoir. La souveraineté populaire est un principe d’opposition. Le peuple devient une catégorie sociale résiduelle et le nouveau principe de légitimité du «régime diversitaire», c’est le progrès de la diversité. De ce point de vue, la démocratie libérale est un régime que l’on doit défendre, mais on doit aussi défendre ses conditions de possibilité qui sont mises en danger. Je sais néanmoins qu’il y a dans une certaine droite libertarienne la tentation d’agir comme la gauche: «Ils ont leur utopie, nous aurons la nôtre.» Ce n’est pas mon cas. Sur ce point, je demeure churchillien, gaulliste, dans la défense du régime démocratique occidental, qui ne s’incarne pas de la même façon dans tous les pays, mais qui est le plus grand défenseur des libertés et qui doit redevenir par ailleurs le défenseur de l’identité des peuples.
A lire aussi | L’étrange définition de la liberté d’expression selon Justin Trudeau
Dans le cadre politique de la démocratie libérale, vous défendez un certain conservatisme. Quel est-il?
Avant tout, le conservatisme est un refus de la table rase. C’est le sens de la durée et de l’histoire. C’est cette idée que la société ne redémarre pas à zéro à chaque génération. Le conservatisme n’est pas le refus de l’examen critique du passé, mais le refus du fantasme de l’anéantissement de ce passé. C’est aussi le refus de la radicalisation du contractualisme, matrice philosophico-politique de la modernité, dont il faut avoir une lecture modérée et intelligente pour qu’il soit fécond. D’un point de vue conservateur, le contractualisme tourne autour de l’idée de consentement politique. Les hommes doivent consentir à leurs institutions, au régime qui est le leur: la démocratie tient dans ce fait. Mais les hommes ne sauraient pour autant penser sous la forme du contractualisme leur association primordiale ou initiale. Le peuple, par exemple, est un fait de culture, un fait d’histoire, un fait identitaire, pour le dire en répondant à Locke ou à Hobbes. Certes, il y a le contrat social. Mais qui sont les contractants? Qu’est-ce qui fait que ces gens-là sont rassemblés pour faire un contrat? La part de l’histoire et du donné, dans la démocratie moderne, ne se laisse pas penser intégralement dans la matrice contractualiste: c’est ce que nous redécouvrons aujourd’hui à travers la question identitaire.
Cette question est-elle vraiment pertinente sur le plan politique et peut-elle même avoir une réponse politique?
La réponse se trouve non seulement chez des penseurs conservateurs, mais aussi chez Rousseau, qui disait que toute bonne constitution doit être pensée à la lumière de la psychologie, des caractères, des traits de chaque peuple. En plus de rappeler à la modernité les limites du contractualisme, le conservatisme rappelle à la modernité sa tentation totalitaire. Il rappelle aussi que, même si la modernité est une étape fondamentale et émancipatrice dans l’histoire humaine, il existe des permanences anthropologiques. Autrement dit, il existe – c’est là l’héritage des philosophies classiques – des «permanences humaines» qui traversent le monde.
Lorsqu’on parle de permanences anthropologiques, on aborde également la question de l’universalité. Dans Le multiculturalisme comme religion politique, vous écrivez que l’affirmation de l’universalisme constitue l’acte fondateur de la gauche. Cependant, dans La révolution racialiste, vous dites qu’il est un rempart à la gauche diversitaire. Y aurait-il donc deux universalismes? Ou une partie de la gauche aurait-elle trahi son idéal?
Je ne poserais pas la problématique de cette façon. Pour le dire simplement, je vois effectivement deux formes d’universalisme. Il y a un universalisme de l’éradication selon lequel il faudrait arracher les hommes à leur culture, leur langue, leur histoire, tous leurs déterminants sociaux et culturels. Pour moi, si on en arrive là, l’homme n’est plus libre, il est nu. Il est condamné à la nudité existentielle, une forme d’«existence sibérienne». Le point de départ de l’universalisme tel que je le conçois se situe plutôt au cœur de chaque culture, dans ses particularités. Il y a ensuite dans chaque culture des possibilités d’adhésion. Chacune tente à sa manière d’interpeler la condition humaine dans son ensemble. Elle porte une idée de l’homme qui transcende les paramètres étroits des différents déterminismes possibles.
A lire aussi | Querelle sur les droits: les droits de l’Homme contre les droits des hommes
Dans ce dispositif, comment concevez-vous l’arrivée de nouveaux arrivants?
Les cultures ont toujours été capables d’adopter de nouveaux membres, et c’est heureux ainsi: une culture n’est pas une race, une nation n’est pas une race. Elles codifient symboliquement la possibilité pour l’étranger de les rejoindre. Pour moi, l’universalisme est ce refus de l’imperméabilité ethnique. C’est le refus de cette forme de communautarisme qui fait en sorte que l’individu est désormais commandé par la pensée de groupe sur le mode clanique. Mais je n’ai pas une définition de l’universalisme sur le mode: «l’Homme serait naturellement Homme, et accidentellement Français, Suisse ou Québécois». Il n’y a pas d’universalité sans médiations.
Vous dites en somme que l’universel ne peut pas être séparé des réalités de chaque pays.
Tout à fait. C’est à partir d’une situation historique et existentielle que l’on aborde la question de l’universel, qu’on aborde une certaine idée de l’homme. On va ensuite chercher à inscrire celle-ci dans un ordre politique et social. Voilà pourquoi je termine La révolution racialiste en disant que l’universalisme à lui seul ne suffit pas. Ce qui est fondamental, ce sont les conditions sociologiques, anthropologiques, politiques et culturelles de cet universalisme. C’est la culture, l’histoire, les mœurs. L’erreur d’un certain républicanisme français, c’est de croire qu’on est naturellement ou immédiatement universel. C’est le privilège involontaire des petites nations, comme le Québec, que de constater le contraire: personne n’est immédiatement universel, le fait de culture est fondamental. Dire «Je suis citoyen du monde» à partir d’Oslo, de Varsovie, de Budapest, de Montréal, de Dublin, ce n’est pas la même chose que de le dire depuis Washington ou Paris. De ce point de vue, je pense qu’il nous faut penser l’universel à la lumière de la situation des petites nations, parce qu’elles sont porteuses d’une lecture du monde qui rappelle l’intrication intime du culturel et du politique.
En France, le cas de Jean-Luc Mélenchon est très intéressant. Cet homme politique se réclame constamment de l’universalisme révolutionnaire, et dans le même temps, son mouvement est le fer de lance de l’idéologie diversitaire en France.
Le jacobinisme intégral de Mélenchon sert de marchepied à la pensée indigéniste, à l’idéologie décoloniale, à la révolution racialiste. Ainsi, Mélenchon nous rappelle que la gauche radicale est toujours à la recherche d’une base, et qu’elle est mue par une obsession de la destruction. Il faut y voir à la fois de l’opportunisme électoral et un changement de fond de sa vision politique. Il fallait détruire hier le vieux monde, maintenant il faut s’appuyer sur ce que la gauche croit être les nouveaux damnés de la terre – les «minorités». Pour moi, c’est moins un paradoxe qu’une fraude, ou à tout le moins, un glissement qui rappelle que la constante chez Mélenchon se situe moins dans les idées que dans l’aspiration révolutionnaire, qui finit toujours par trouver sa base. Et elle la trouve aujourd’hui – pourrait-on dire – dans le 93 [ndlr: en Seine-Saint-Denis].
Y croit-il vraiment ou est-ce là une logique électoraliste?
Ce n’est pas que de l’électoralisme, même si c’est aussi cela. Je pense que le point central de cette tendance de la gauche est toujours la recherche du nouveau sujet révolutionnaire. On le voit dans l’histoire de la gauche. Pour Lénine, par exemple, la classe ouvrière n’a pas nécessairement une conscience révolutionnaire en elle-même, mais plutôt une conscience trade-unioniste. Il faut donc réintroduire le principe de représentativité dans la théorie révolutionnaire, et c’est le parti qui est censé incarner cette conscience révolutionnaire manquante à la classe ouvrière laissée à elle-même. Ensuite, dès les années cinquante, se pose à travers l’anticolonialisme cette idée que les masses ouvrières ne souhaitent pas faire la révolution. La gauche se tourne donc vers le tiers-mondisme. S’impose ensuite la recherche du tiers-monde intérieur avec les nouveaux sujets révolutionnaires dans les années soixante, septante et huitante : aux ouvriers succèdent les exclus, les minorités. Ce dont a besoin la gauche avant tout, c’est une catégorie sociale d’exclus supposés pour légitimer une prétention révolutionnaire à renverser l’ordre social.
A lire aussi | Droit de vote des étrangers: la logique sans fin du PS
On remarque qu’aujourd’hui la sociologie est devenue une arme idéologique, et dans bien des cas le laboratoire des idées de la gauche diversitaire. Y aurait-il là quelque chose d’intrinsèque à la sociologie ?
Tout dépend de la façon dont vous la définissez. Quand Raymond Aron écrit Les étapes de la pensée sociologique, il remonte à Montesquieu, à Tocqueville, à Durkheim. Il cherche à identifier les constantes de l’existence sociale, ses structures symboliques ou empiriques. Cette recherche de permanences est un projet tout à fait fascinant en lui-même. Hélas, à partir des années 50-60 et jusqu’aujourd’hui, la sociologie est devenue d’un côté le lieu d’expérience idéologique de tous les radicalismes et d’un autre côté une technique d’ingénierie sociale. Pourquoi? Parce que le développement de l’Etat social thérapeutique fait en sorte qu’il a besoin d’outils conceptuels pour justifier, théoriser et légitimer sa reconstruction de toutes les relations sociales. C’est dans la nature de la bête en quelque sorte. La sociologie trouve là un espace de déploiement administratif qui lui donne un pouvoir immense sur la reprogrammation de nos sociétés. Plus encore, puisque toutes les relations sociales sont en passe d’être reconstruites, tout doit être rééduqué. Par conséquent, la sociologie devient la discipline mère d’une société entièrement rationalisée, bureaucratisée, étatisée.
Qu’en est-il dans le monde académique?
Sur le plan idéologique à l’université, à partir du moment où il y a une forme d’intoxication idéologique de la sociologie (qui est due avant tout au marxisme et au post-marxisme qui se sont redéployés dans la sociologie comme discipline militante), les canons de reconnaissance académique et scientifique se confondent avec des critères idéologiques. C’est l’effet de la théorie critique selon laquelle une théorie ne doit pas expliquer l’ordre social, mais porter en elle une critique et un appel à la déconstruction, la refondation, et le procès de l’ordre social. Il y a donc dans les universités une sorte de prime à la radicalité.
C’est-à-dire, concrètement?
Vous devez toujours pousser plus loin le procès du monde occidental pour obtenir vos titres académiques, et si vous ne participez pas à ce mouvement, vous risquez d’être mis de côté par les institutions subventionnaires et l’université plus largement. Dans l’espace public, les codes de la reconnaissance idéologique et symbolique, le fait par exemple d’avoir le titre de sociologue de référence ou non, viennent avec le fait de participer à ce mouvement ou non. La sociologie est donc prise aujourd’hui dans une forme d’emportement. C’est ce que j’appelle la «lyssenkisation» des sciences sociales. Il est fascinant de voir que nous vivons dans un monde qui fabrique les vérités dont il a besoin pour qu’elles soient conformes à l’idéologie.
C’est l’éternel problème de la morale qui contamine la science.
Evidemment, mais il n’y a jamais d’imperméabilité absolue entre l’une et l’autre. Je ne me fais pas d’illusion, surtout quant aux sciences humaines. Elles sont «humaines» avant d’être des «sciences». Cela dit, il devrait y avoir un devoir sinon d’objectivité, à tout le moins d’honnêteté. Or, méchamment, je dirais qu’une bonne partie du travail des sciences sociales consiste aujourd’hui à expliquer que ce qui arrive n’arrive pas. Elles sont dans une logique typiquement orwellienne de négation de l’événement. La «théorie du genre», par exemple, me fascine: on en vient à nier l’existence du masculin et du féminin. C’est quand même original comme idée! Aujourd’hui, on présente comme une évidence absolue le fait que l’homme et la femme n’existent pas et que la biologie serait génératrice de catégories sociales réactionnaires. Holà! On a quand même un problème.
Mais la théorie du genre – dans le cas de Judith Butler qui en est peut-être la théoricienne la plus importante – est une théorie d’abord philosophique, non?
Oui, mais promenez-vous dans les départements de sciences sociales, vous constaterez que cette théorie s’est normalisée partout. Autour de la théorie du construit social, on va nous expliquer que tout est une construction sociale en toute circonstance. On va même pousser cette théorie très loin en disant par exemple que le handicap est un construit social, que la distinction entre l’homme et l’animal est un pur construit social. Il y a une sorte de fantasme d’anéantissement qui s’exprime à travers cela. Il est aussi fascinant de voir ce que disent les sciences sociales au sujet de l’immigration. Les sociétés occidentales sont traversées par des mouvements migratoires massifs et elles connaissent des mutations démographiques significatives. Dans ce contexte, tout le travail de la sociologie consiste à expliquer que ça n’arrive pas, en étendant sans cesse les critères de la nationalité, de l’appartenance, de l’identité. Mais une fois que c’est arrivé, la sociologie est là pour nous dire que c’est inéluctable et que la critique de ce qui arrive ou est arrivé est inacceptable. Je crois qu’il y a aujourd’hui une corruption intellectuelle des sciences sociales et je m’en désole, parce qu’elles portent en elles un projet magnifique.
Ecrire à l’auteur: antoine.bernhard@leregardlibre.com
Vous venez de lire une interview tirée de notre édition papier (Le Regard Libre N° 77).
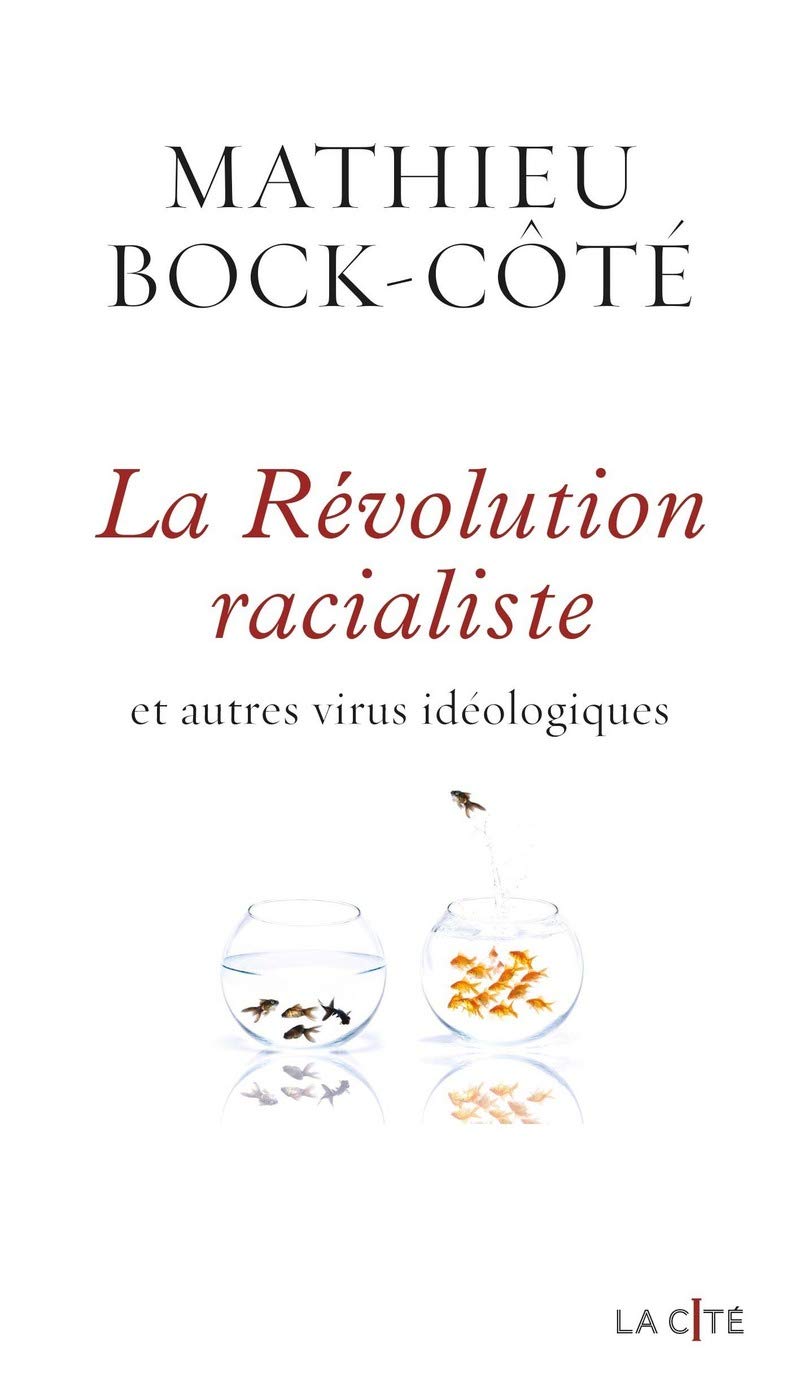
Mathieu Bock-Côté
La révolution racialiste (et autres virus idéologiques)
Presses de la Cité
2021
238 pages



