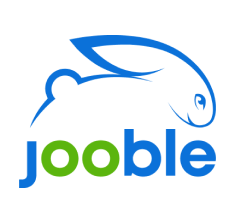Sous couvert d’inclusion et de justice sociale, l’université sacrifie trop souvent la rigueur scientifique à l’idéologie. Cette dérive compromet sa mission première, selon l’historien Olivier Moos: éclairer le réel plutôt que servir des causes.
Analyse
-
Chateaubriand ne séduit plus les jeunes. L’impact politique de ses écrits fut pourtant considérable au XIXe siècle, à tel point qu’il fut longtemps considéré comme l’un des phares d’une jeunesse révoltée. Son style, qui rebute aujourd’hui, n’y est pas pour rien.
(suite…)
Ce contenu est réservé à nos abonnés.
 Si vous avez un compte, connectez-vous. Sinon, découvrez nos différentes formules d’abonnements et créez un compte à partir de CHF 2.50 le premier mois.
Si vous avez un compte, connectez-vous. Sinon, découvrez nos différentes formules d’abonnements et créez un compte à partir de CHF 2.50 le premier mois. -
Quand le dirigeant d’une nation propose de diffuser une œuvre de fiction pour éduquer des élèves, il est temps de se demander s’il est bon de se fier à cette dernière pour façonner notre rapport au réel.
-
Il n’y a pas d’harmonie sans mélodie. Cette dernière est première en musique et le terme anglais de tune permet de mieux saisir son essence à la fois sonore et sémantique.
(suite…)
Ce contenu est réservé à nos abonnés.
 Si vous avez un compte, connectez-vous. Sinon, découvrez nos différentes formules d’abonnements et créez un compte à partir de CHF 2.50 le premier mois.
Si vous avez un compte, connectez-vous. Sinon, découvrez nos différentes formules d’abonnements et créez un compte à partir de CHF 2.50 le premier mois. -
Ce mois-ci, notre chroniqueur cherche à comprendre le désintérêt croissant du public occidental envers les productions du géant du divertissement, à travers l’œuvre du journaliste et sociologue Siegfried Kracauer.
-
La galanterie est-elle un instrument de soumission de la femme? Certainement pas, selon Jennifer Tamas, spécialiste de la littérature française du XVIIe siècle et auteure d’un essai récent sur le sujet.
(suite…)
Ce contenu est réservé à nos abonnés.
 Si vous avez un compte, connectez-vous. Sinon, découvrez nos différentes formules d’abonnements et créez un compte à partir de CHF 2.50 le premier mois.
Si vous avez un compte, connectez-vous. Sinon, découvrez nos différentes formules d’abonnements et créez un compte à partir de CHF 2.50 le premier mois. -
Dans la tourmente pour s’être rendue en avion dans la péninsule arabique, la politicienne verte a rendu malgré elle un hommage appuyé à la pensée de l’historien américain Christopher Lasch, auteur de «La révolte des élites» (1994).
-
Remake, prequel, sequel, spin-off: ces néologismes ne sont que trop familiers au public contemporain. Au cinéma ou sur les plateformes, films et séries recyclent les recettes du passé, signe d’une époque qui ne sait se réinventer.
(suite…)
Ce contenu est réservé à nos abonnés.
 Si vous avez un compte, connectez-vous. Sinon, découvrez nos différentes formules d’abonnements et créez un compte à partir de CHF 2.50 le premier mois.
Si vous avez un compte, connectez-vous. Sinon, découvrez nos différentes formules d’abonnements et créez un compte à partir de CHF 2.50 le premier mois. -
La musique suisse incarne un esprit helvétique décentralisé, issu de la cohabitation des diversités culturelles du pays.
(suite…)
Ce contenu est réservé à nos abonnés.
 Si vous avez un compte, connectez-vous. Sinon, découvrez nos différentes formules d’abonnements et créez un compte à partir de CHF 2.50 le premier mois.
Si vous avez un compte, connectez-vous. Sinon, découvrez nos différentes formules d’abonnements et créez un compte à partir de CHF 2.50 le premier mois. -
Cinéma
Le western, l’interminable séance de psychanalyse américaine
par Jocelyn Dalozpar Jocelyn DalozLe western révèle comme nul autre genre à quel point les Etats-Unis sont centrés sur eux-mêmes et leur passé. Chaque film s’apparente à une énième séance d’autothérapie, souvent nombriliste – et de plus en plus répétitive.
(suite…)
Ce contenu est réservé à nos abonnés.
 Si vous avez un compte, connectez-vous. Sinon, découvrez nos différentes formules d’abonnements et créez un compte à partir de CHF 2.50 le premier mois.
Si vous avez un compte, connectez-vous. Sinon, découvrez nos différentes formules d’abonnements et créez un compte à partir de CHF 2.50 le premier mois.