Une magnifique nuit se lève pour Elisabeth Quin

Les bouquins du mardi – Jonas Follonier
La présentatrice de télévision française Elisabeth Quin, également écrivain, a consacré son dernier ouvrage en date paru début 2019 à un enfer qu’elle-même traverse: celui de la perte de la vue. D’une extrême sensibilité, ce joyau livresque a surtout une grande vertu: celle de la vérité directe des sensations.
Elisabeth Quin a choisi l’un des meilleurs sujets qui soient sur le plan littéraire comme sur le plan philosophique: la vue. C’est qu’il s’agit là du sens le plus spirituel qui soit. Voir, c’est en quelque sorte déjà comprendre, apprendre, découvrir. Aristote le premier l’avait senti et théorisé. «Senti», voilà la clef de ce livre La nuit se lève publié au début de cette année aux Editions Grasset & Fasquelle. Elisabeth Quin – on le constate plus que jamais à la lecture de ce récit personnel hautement littéraire – est une personne sensible, et je dirais même sensationnelle, du fait de son talent à transmettre ses sensations. Par sensations, comprenons leur sens premier: des impressions sensibles, c’est-à-dire venant directement des cinq sens. Comme l’auteure l’exprime très bien à travers ses lignes, c’est quand on en perd un, de sens, que son importance prend tout son sens. La nuit se lève, c’est de bout en bout cette belle prise de conscience.
«La vue va de soi, jusqu’au jour où quelque chose se détraque dans ce petit cosmos conjonctif et moléculaire de sept grammes, objet parfait et miraculeux, nécessitant si peu d’entretien qu’on le néglige.»
Si les personnes à lunettes de soleil sont pour Elisabeth Quin – qui les croise dans la rue – des «sosies déplorables et bouleversants de Stevie Wonder, Ray Charles, et aussi Gilbert Montagné», l’auteur, elle, peut être considérée comme une réincarnation littéraire de Michel Polnareff. Apprenant qu’il était atteint d’une double cataracte, l’artiste avait lui aussi dû affronter la peur de devenir aveugle. C’était à la fin des années quatre-vingt et au tout début des années nonante, quand l’intrigant auteur-compositeur-interprète était resté cloîtré huit cents jours au palace Royal Monceau, composant et enregistrant son album Kâma-Sûtrâ avec la pépite Goodbye Marylou. Pas de doute que la tonalité et le propos de cette œuvre admirable doivent une partie de leur puissance au mal-être d’un Polnareff tétanisé par sa vue en baisse, qui avait choisi de demeurer en ermite dans cet établissement après en avoir appris les contours.
Ainsi en est-il du récit d’Elisabeth Quin, renversante de sincérité dans ce qui se comprend comme la transcription artistique d’un vécu. L’auteure y flirte avec la peur de la mort d’un organe, la mort d’un sens, la mort tout court, mais fréquente également la philosophie, présente à chaque page dans son acception la plus accessible et universelle. Comparant ses globes oculaires au globe terrestre (lui aussi malade), se questionnant sur ce que deviendrait sa relation avec son conjoint si elle venait à perdre complètement la vue, évoquant une séance médicale comme un rapport intime (ce qu’elle est), Elisabeth Quin met surtout le tout dans une forme des plus sublimes, bien que très directe. Sans doute cette transparence est-elle même nécessaire à une telle évidence stylistique. Un style, en effet, qui en impose et donc s’impose de lui-même.
«Elle ouvre les yeux, me fixe, et oppose un silence obstiné à chacune de mes questions. Veut pas parler. J’enfile mon manteau et pépie d’une voix infantilisante ‘‘ma petite maman chérie je pars travailler, il est 9h30, je t’appelle ce soir’’. Son regard soutient le mien, sans cligner, et dans ces yeux dont l’acuité faisait sa fierté, ‘‘tu te rends compte, me disait-elle à quatre-vingt-cinq ans, j’ai 10/10 à chaque œil’’, ces yeux d’oiseau de proie qui m’ont couvée, scrutée, jalousée, mal aimée mais tant aimée, bon sang, dans les yeux de cette femme qui n’a jamais eu la moindre idée de qui je suis vraiment, je vois la peur, je lis un reproche, un défi hargneux, un vrai désespoir, je lis ‘‘tu m’as abandonnée, je me laisse mourir, regarde ce que tu fais de moi’’. Je fuis. Coupable jusqu’au bout, et incapable de trouver du réconfort auprès d’elle. Au rez-de-chaussée, un flot de larmes.»
Outre la génie artistique du présent récit, comme le passage que je viens de citer vous l’aura sans doute montré, La nuit se lève est également gorgé d’humour. D’humour fin, mais pas finaud. Cet humour qui nécessite une intelligence qui l’exprime mais qui ne suppose pas que son récepteur soit particulièrement brillant. S’ajoute à cet humour des réflexions sur la télévision, forcément. Et c’est ce qui, sans conteste, ressortira de plus passionnant dans cette livraison Grasset: le traitement du thème du regard. Car il semblerait qu’Elisabeth Quin soit cette personne qui, du fait même qu’elle est atteinte d’un glaucome, réapprend, ou tout simplement apprend, son regard. Qu’elle le façonne. Qu’elle y réfléchit. Et qu’elle nous le livre. Un regard à ses invités sur le plateau d’Arte, un regard à ses lecteurs. Un regard libéré. Un regard libre.
Ecrire à l’auteur: jonas.follonier@leregardlibre.com
Crédit photo: © YouTube / La Grande Librairie
Elisabeth Quin
La nuit se lève
Editions Grasset & Fasquelle
2019
141 pages





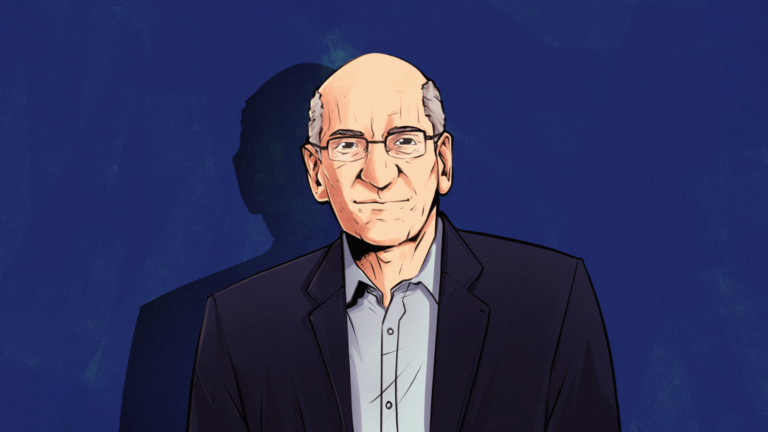



Laisser un commentaire