«Le Sang», extrait n° 6

Le Regard Libre N° 30 – Sébastien Oreiller
Chapitre II : Arrivée du fils
Il y avait quelques retouches à faire. A peine. Elle passait ses mains sur le tissu souple, les hanches et les côtes, d’un œil expert, pensait-elle. Comme s’il ne remarquait rien. Elle tremblait. C’était les habits de son fils, celui qui allait bientôt arriver. Longues bottes noires, pantalons d’équitation et large chemise. Autour du cou, une cravate, assez ample, presque un foulard. Ils faisaient quasiment la même taille ; à peine était-il un peu plus petit et fin. Elle allait les reprendre. Elle en avait assez de ces habits de jardin, vieux haillons de grosse toile. Lui aussi se trouvait beau dans le miroir, presque trop bronzé dans ces habits qui sentaient l’homme, l’homme riche surtout, celui qui ne se refuse rien.
Il pouvait les garder, mais ici seulement. Les prendre au village, c’était hors de question. Pourquoi pas en fait. Non, on l’aurait vu, on aurait compris, on n’aurait peut-être rien dit, mais les autres femmes l’auraient trouvé beau, elles aussi. Non, il ne valait mieux pas. Et son fils ? Il serait jaloux, bien sûr, mais qu’importe. Ces habits, il ne les mettait plus ; c’était pour ça qu’il les avait laissés là. Il grimaça.
En rentrant chez lui, il vit que la vigne était devenue verte, d’un vert vif, presque fluorescent. C’était l’époque la plus chaude de l’année, et la plus agréable, du moins pour ceux qui ne travaillaient pas. Même les raisins étaient verts, s’abreuvaient de soleil, petits serpents glaciaux entre les murets brûlants. Il s’épanouissait dans sa force, sèche et chaude, comme l’air qui montait de la plaine pour former des orages, ombres courant contre les versants, comme lui ne sachant où s’enfuir pour éclater. Il s’assit sur un muret au-dessus de la route, les pieds dans la terre odorante de vie, comme un cep à la sève montante, et il s’alluma un petit cigare. Elle lui en avait fait cadeau. Autrefois, c’était à peine s’il avait fumé la pipe, un mauvais tabac qu’il économisait en le mélangeant aux herbes. Celui-là était meilleur, comme tout ce qui venait de loin. Entre les volutes de fumée, il discernait la plaine, et jouissait comme en rêve de ce qu’il était devenu, la peau sale et en guenilles. Sous lui, ils passèrent dans une petite Ford sans toit. Cela le fit bien rire. Il jeta le cigare sur la route et partit.
La mère lui demanda de s’occuper de la petite ; elle voulait se reposer un peu, c’était difficile en ce moment. Il prit la petite sous les bras et la posa sur ses épaules. Il l’entendit rire, là-haut, juste parce qu’elle jouait avec son grand frère, et qu’elle l’aimait. Il se demanda pourquoi il ne riait plus lui aussi de cette manière-là. Comme avant dans les vignes, presque un rire de méchanceté. Et pourtant le rire de la fillette, ce plus beau rire, qu’il devait être insipide, sans larmes ni sang. Il ne connaîtrait plus jamais cette joie d’être faible et de s’en moquer, juste parce qu’on ne peut rien y faire, et qu’on en profite. Et comme toujours, il se mit à détester ce qu’il ne pouvait pas avoir. Un rire d’imbécile, d’imbécile heureux. Lui ne dépendait de personne, pensa-t-il en posant la gamine à terre, presqu’en la jetant, tandis qu’il essayait d’oublier qu’à présent, c’étaient les autres qui dépendaient de lui. Son odeur, celle de ses petits baisers pleins d’amour, lui collait à la peau. Il partit se laver.
Ecrire à l’auteur : sebastien.oreiller@netplus.ch
Crédit photo : © valais.ch






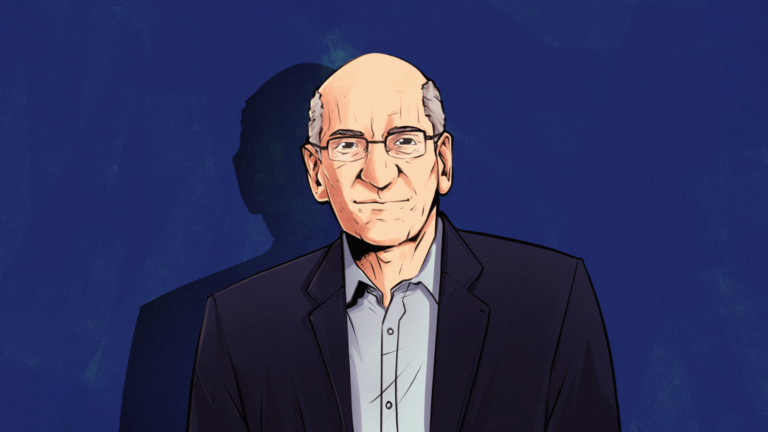


Laisser un commentaire