«Le Sang», extrait n° 1

Le Regard Libre N° 25 – Sébastien Oreiller
Chapitre I : La Perte
Ils ne sont pas nés vieux. Tout au plus leurs jours, des vignes sucrées de novembres, ont-ils coulé plus rares et plus denses sur la terre rouge, la terre assoiffée qui dicte, au gré des semailles et des moissons, les joies et les peines. Avares en tendresses, ils ont veillé avec l’œil de celui qui n’a rien sur le peu qu’ils avaient, leurs joies muettes, et c’est pour ça qu’ils les ont chéries sur nos traits, bien des années plus tard, quand nous leur avons souri. Nés de malheurs silencieux. Nés des joies mortes de leur jeunesse.
Ils ont passé comme un ruisseau d’eau froide dans la montagne, en courant sous le soleil, et pourtant, eux aussi, ils ont été jeunes. Brièvement. Le père de mon père n’avait pas vingt ans, quand il la perdit, sa jeunesse, un jour qu’il était aux champs. Il l’avait prise avec lui en partant, par la main, et il l’avait laissée jouer pendant qu’il travaillait, seul, au bord des bois qui dominent la plaine. Comme toujours quand la journée avait touché à sa fin et que la sueur brûlait son cou laborieux, elle s’était tue, il n’avait plus entendu son chant, celui des cascades et des petits enfants. Il avait appelé sa jeunesse, et il ne l’avait pas trouvée. Peut-être s’était-elle perdue, volage, là où les taillis sont incultes et les gorges avides, dans les creux où, parfois, l’esprit emmène les jeunes gens, et dont ils ne reviennent pas. Peut-être aussi était-il devenu sourd, comme son père qui était mort sept mois plus tôt, fatigué comme lui, et il n’avait pas eu le courage de la chercher.
Chez lui, espérant qu’elle l’aurait précédé, il ne trouva que le feu dans l’âtre, et au-dessus de l’âtre, l’image chérie du père. « Je t’attendais. » lui dit la mère, et il embrassa ses joues ridées, qui avaient vu naître, et parfois mourir, sept enfants, dont il était le premier. Il prit la cadette sur les genoux, encore ronde et blonde comme quelque chose qui se mange, une friandise dorée au soleil et qu’on lui aurait oubliée ; elle ne resta pas et s’enfuit, elle aussi, mais plus gaiement, rampant vers la vilaine poupée héritée de ses sœurs. Ce fut au tour des garçons. Trois d’entre eux. Jeunes encore, mais comme lui déjà promis à devenir forts et à plier la terre sous leurs épaules ; pour l’heure, pendant que la mère soignait la vigne et les arbres à pommes, c’étaient les bêtes qu’ils domptaient de leurs longues baguettes, une ou deux têtes chacun, presque aussi jeunes qu’eux, et comme eux espoirs du troupeau. Ils étaient rouges et bruyants, certains n’avaient pas de dents, mais tous s’agitaient sur le banc de bois à côté de lui. Lui ne disait rien.
Debout sur le sol rustique, sa mère le vit, et comprenant dans son cœur de mère, elle lui sourit en lui versant une tasse de ce mauvais café que l’on buvait même le soir, avec du pain noir. Il était déjà dur, sans même que le soleil et les soucis, comme aujourd’hui, ne le rendissent plus grand encore aux yeux des autres, et plus dangereux peut-être. Tel la mère voyait-elle le fils, mais déjà, la gamine était revenue, réclamait, de ses poumons édentés, la même collation que ses frères.
C’était le soir, le premier soir avare en jeunesse, qui pénétrait par effluves de lavande et de mauve dans sa petite chambre, imprégnant ses draps de tiède tendresse, et lui montait à la tête. Il faisait couler l’eau fraîche de la montagne sur son corps encore brûlant des travaux d’été, ôtant de ses jambes les souillures de la terre ingrate, de son dos la mâle odeur de la sueur. Dehors, c’étaient les feux de la Saint-Jean dans la nuit encore claire. Il ne voulait pas y aller, il n’y irait pas, sachant trop bien que sa jeunesse ne pouvait y être, hostile qu’elle était aux clameurs et aux cris inutiles. Et pourtant, il n’avait pas le choix ; son visage l’avait rendu triste dans la glace, et il fallait oublier.
Ecrire à l’auteur : sebastien.oreiller@netplus.ch






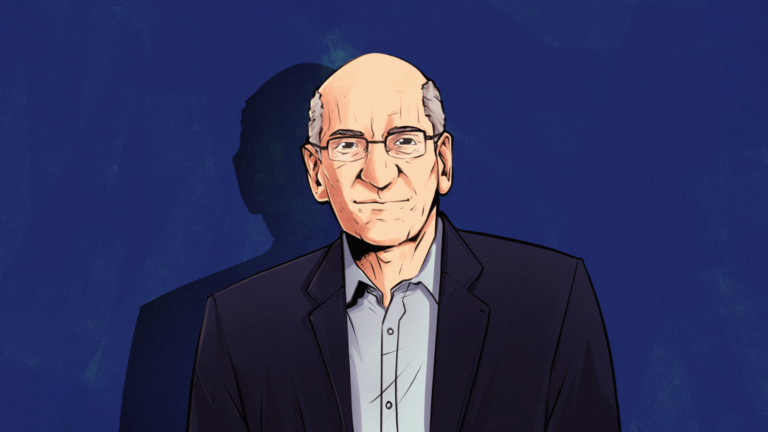


Laisser un commentaire