La traduction, un acte de lecture
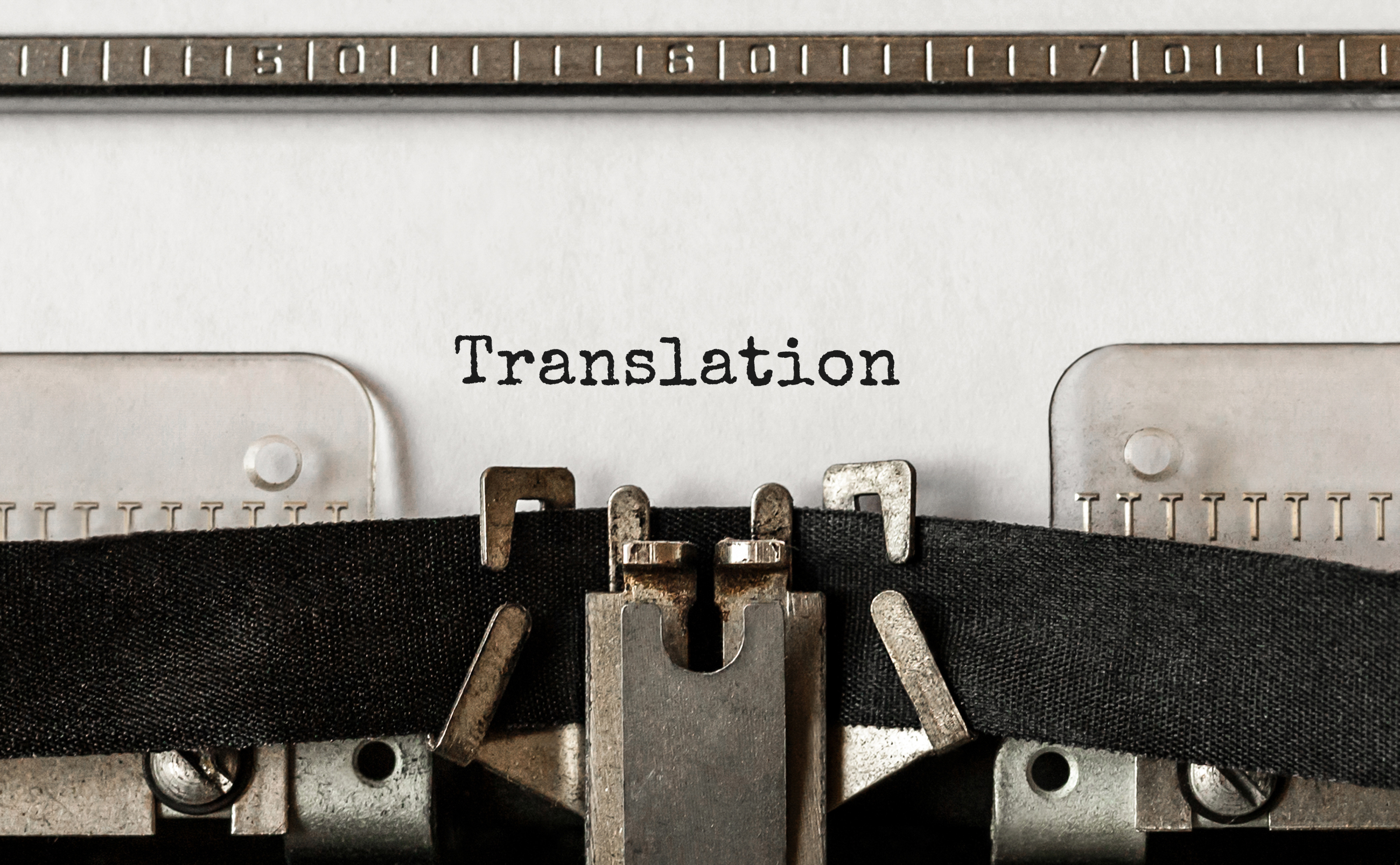
Le Regard Libre N° 47 – Hélène Lavoyer
«La langue de l’Europe, c’est la traduction», écrivait Umberto Eco dans son ouvrage Dire presque la même chose. Qu’entendait-il par là? Que l’Europe s’est construite dans la découverte de l’autre par le biais de sa propre langue en rapport à celle de l’autre, certes, mais pas seulement: que la traduction, sujet qui nous intéressera au fil des prochains paragraphes, a été jusqu’ici la manière d’être même de l’Europe. Et ce, dès les textes fondateurs de notre continent. De la Bible à la philosophie, du Cantique des Cantiques à la Métaphysique d’Aristote, les soubassements de la pensée occidentale – aussi diversifiée et hétéroclite qu’elle puisse être – reposent sur des textes traduits.
En Suisse, le débat sur le prix des avions a décollé et une initiative va être lancée pour taxer les vols au nom de l’écologie. D’autres affaires, comme celle d’Airbnb, agitent les plus grandes villes du monde, qui souhaiteraient mieux encadrer la plateforme de location afin d’éviter la montée des prix et la pénurie de logement. Deux figures représentatives des problèmes liés au tourisme, Barcelone et Venise, tirent la sonnette d’alarme face à la submersion des visiteurs.
J’aimerais ici apporter à l’esprit du lecteur quelques réflexions et remarques concernant cet exercice périlleux, magnifique, long et difficilement achevé qu’est la traduction. Quels sont les enjeux et les tensions sur lesquels l’attention du traducteur doit être posée? Quelle liberté ce dernier peut-il s’octroyer? En prenant l’exemple du chinois, dont l’approche a été possible grâce aux Trois essais sur la traduction de Jean François Billeter, en me laissant au mieux habiter par les commentaires et analyses de Barbara Cassin et d’autres traducteurs, j’ai tenté d’apporter, par la langue, des pistes de réflexion. Et d’ouvrir une porte sur l’acte de traduire ainsi que sur l’importance de garder vivantes les langues – une activité qui, nécessairement, constitue également un acte politique.
Visions du monde
La traduction doit-elle s’occuper, comme ce fut successivement le cas au Moyen Age puis à la période romantique, de traduire le mot (c’est-à-dire, de trouver son équivalent sémantique exact), sans s’intéresser au contexte? Au contraire, le traducteur est-il autorisé à traduire le sens du texte ou de l’énoncé dans son ensemble, ce que le texte lui évoque en lien avec la volonté de l’auteur et le contexte historico-géographique dans lequel ce dernier vivait? Les deux avis s’opposent largement. Le premier ferme la porte à la subjectivité du traducteur, qui est également et tout d’abord un lecteur, et considère que la traduction de l’unité linguistique prime sur une herméneutique, laquelle est centrale pour les tenants de la seconde conviction.
Chaque langue influence radicalement la perception qu’un individu a du monde. Grâce aux mécanismes de chaque langue sont nés des styles singuliers et des rythmiques uniques pour décliner le rapport au monde. La traduction est donc non seulement la transmission d’un texte, d’un énoncé ou d’un mot, mais encore elle véhicule une conception du monde, une certaine vision. Ainsi, la traduction dite «littérale» est insensée pour les expressions idiomatiques et, peut-être plus encore, lorsqu’elle est appliquée dans le domaine de la poésie. L’exemple suivant éclaire bien l’impossibilité de traduire mot à mot une expression idiomatique: «sich aus dem Staub machen» a le même sens en allemand que «prendre la poudre d’escampette» en français. Littéralement, la phrase se traduit pourtant par: «s’éloigner de la poussière».
«En rendant shen par ‘‘esprit’’ nous avons introduit dans notre traduction, que nous le voulions ou non, l’idée d’un ‘‘esprit’’ opposée à un ‘‘corps’’. Or on trouve certes en chinois classique des équivalents de notre mot ‘‘esprit’’ et de notre mot ‘‘corps’’, mais ils n’ont jamais entre eux le même rapport que les deux mots français. […] l’âme ou l’esprit sont pour eux une manifestation supérieure de l’activité corporelle.» (Billeter, 2014)
Jean François Billeter, sinologue et philosophe, propose de passer par le chinois pour parler de l’exercice technique – fait de percées et de retours en arrière – qu’est le traduire. Cette langue semble en effet destinée à éclairer les tenants et aboutissants qui se jouent en traduction grâce aux différences monumentales entre le chinois et le français. Le contraste n’en est que plus frappant quand, pour dire de quelqu’un qu’on ne saisit pas le sens de ce qu’il dit, on utilise l’expression «il parle chinois». Dans le premier de ses trois essais sur la traduction, Billeter démontre l’importance, dans la poésie chinoise, de l’événement. Le poème peut toutefois décrire un épisode sans en expliciter le moment en rapport avec un contexte temporel plus large, contrairement au français ou les temps sont cruciaux et constamment précisés.
A propos de la poésie chinoise classique: «On ne peut pas la traduire, mais on peut suggérer ce qu’elle fut. Elle naît le plus souvent de moments vécus, parfois situables et datables dans la vie du poète. Alors que le haïku ne dépasse jamais l’instant, le poème chinois classique comporte presque toujours une articulation temporelle forte – quoique inapparente, puisque les temps des verbes ne sont pas exprimés.»
Un autre aspect qui vient appuyer l’idée d’une pluralité de visions du monde est que chaque environnement, global ou privé, forge également la perception, l’opinion. Si traduire implique de tenter de comprendre une culture, la nécessité de connaître la biographie de l’auteur et les contextes dans lesquels il évoluait est indiscutable; pour autant, le traducteur lui-même est intriqué dans des contextes socioculturels, et ne peut s’en détacher. Sa langue aussi est le résultat de changements et ce qu’hier, il exprimait par le mot «friponneau», il le décrirait aujourd’hui naturellement par «espiègle».
Un acte politique
Assurément, la traduction comme entendue par Jean François Billeter est une responsabilité. Responsabilité de connaître l’auteur, ses intentions, de deviner derrière les mots ce qui n’est pas dit tout en l’évoquant avec autant de finesse que celle qu’a eue l’écrivain. A cette tâche immense, qui est finalement celle de ne pas trahir, s’ajoute le devoir d’entretenir l’honnêteté envers soi, de la travailler et de déceler les effets du texte sur le lecteur. D’un autre point de vue, la traduction est un acte politique, pouvant servir à répandre ou résorber des idéologies – notamment en (re)traduisant des textes fondamentaux, en y intégrant une doctrine.
Dans l’Europe occidentale que nous connaissons aujourd’hui, où les réseaux de communication sont en expansion et où les déplacements à l’extérieur des frontières nationales sont de plus en plus possibles et fréquents, la nécessité de comprendre et de se faire comprendre se traduit par l’avènement du «globish», ou «global english». En effet, les relations entre individus et nations ont aidé à installer cette langue qui n’en est pas vraiment une, si globale qu’elle en perd les richesses de complexité et les finesses de l’anglais dont elle est issue; le globish est donc une sorte de novlangue qui, sans conteste, contribue à l’hégémonie américaine.
Persister à traduire, c’est s’indigner et former un blocus contre ce globish qui compresse toujours plus l’utilisation des autres langues dans l’espace des sphères privées et dissout également la pluralité des conceptions du monde sans questionner celle qu’il véhicule. La traduction est cet effort de «faire passer» quelque chose qui nous est cher ou qui nous semble important. Il s’agit d’un pont fragile dont le passage ne laisse pas intact. La traduction constitue un deuil de la perfection qui n’a rien de triste mais qui permet de rendre compte de ce que Barbara Cassin appelle les vérités, «avec un ‘‘v’’ minuscule et un ‘‘s’’», en opposition à l’idée d’une Vérité universelle, ancrée dans la pensée occidentale. Elle proteste pour elle-même mais également pour le maintien des différences en parallèle à la création de passerelles entre ces visions du monde.
«[…] je crois que le mot travaille la chose, le fait d’être d’une certaine manière. Prenons khaire, le mot grec qu’on utilise pour saluer. Il ne signifie pas du tout bonjour, ni good morning ou welcome, il veut dire très littéralement ‘‘jouis, prends plaisir, réjouis-toi’’. Quand on se salue dans cette langue, on ne dit pas ‘‘passe une bonne journée’’ ou ‘‘que le jour soit bon’’, on dit ‘‘jouis’’, ce n’est pas pareil! C’est un monde qui se dessine là. Quand un Latin rencontre ou quitte un autre Latin, il lui dit: Vale, ‘‘porte-toi bien’’, ‘‘sois en bonne santé’’. C’est encore un autre monde. Quand on dit ‘‘bonjour’’ en hébreu ou en arabe, on dit shalom, salam, ‘‘que la paix soit avec toi’’. Le monde s’ouvre de manière complètement différente selon la langue, si l’on vous dit ‘‘passe une bonne journée’’, ‘‘jouis’’, ‘‘porte-toi bien’’, ou ‘‘la paix soit avec toi’’.» (Cassin, 2012)
Ecrire à l’auteur: helene.lavoyer@leregardlibre.com
-
 Le Regard Libre – N° 47CHF10.00
Le Regard Libre – N° 47CHF10.00 -
 Abonnement standard (Suisse)CHF100.00 / année
Abonnement standard (Suisse)CHF100.00 / année -
 Abonnement de soutienCHF200.00 / année
Abonnement de soutienCHF200.00 / année





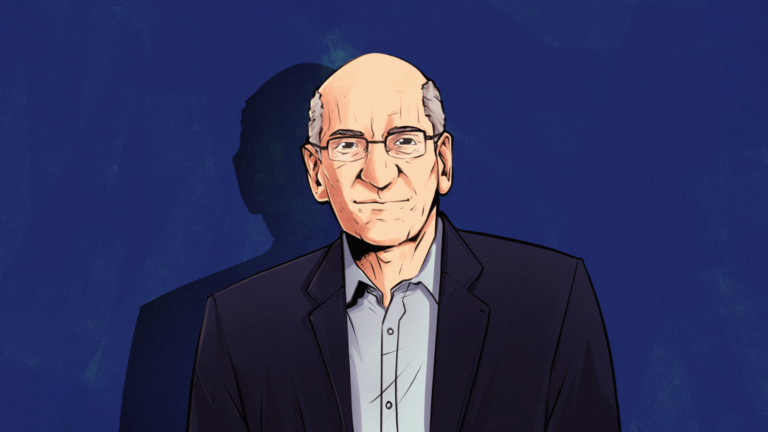



Laisser un commentaire